
Litiges ou gestion de la carrière des agents publics
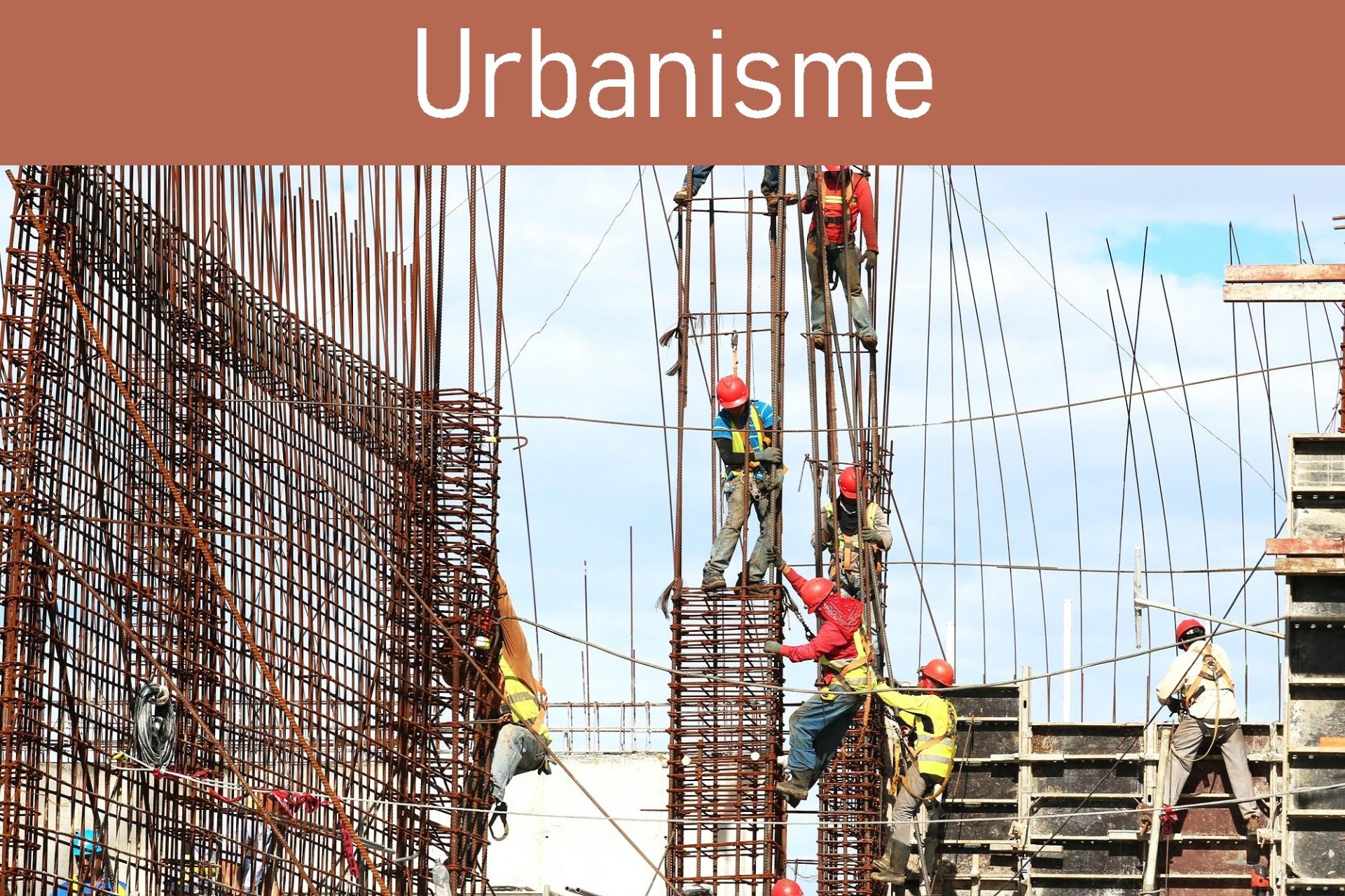
Un accompagnement dans vos difficultés liées à une construction

L'accès ou le déroulement des études universitaires
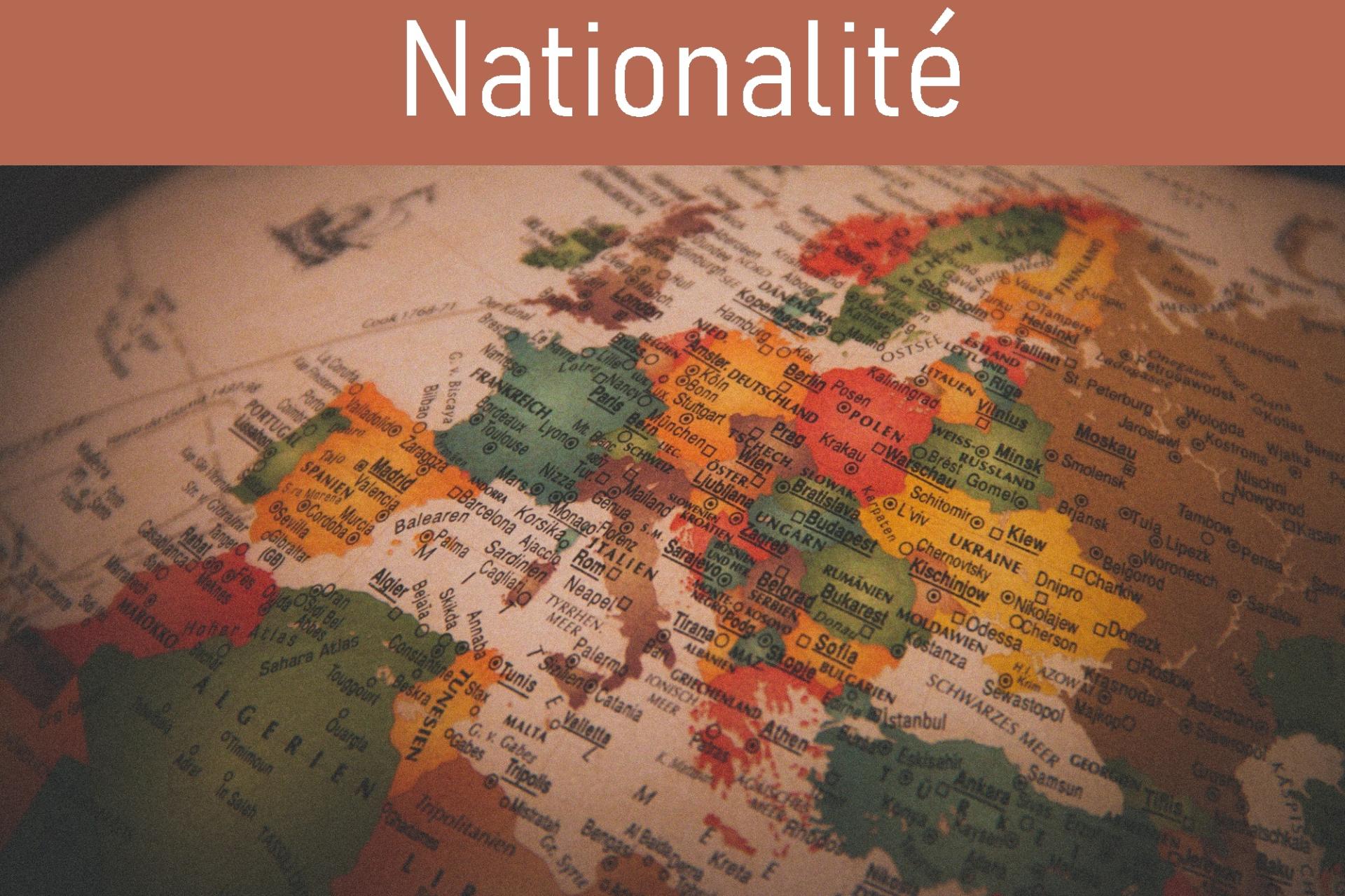
Obtenir ou récupérer la nationalité française

Tout litige avec les administrations publiques
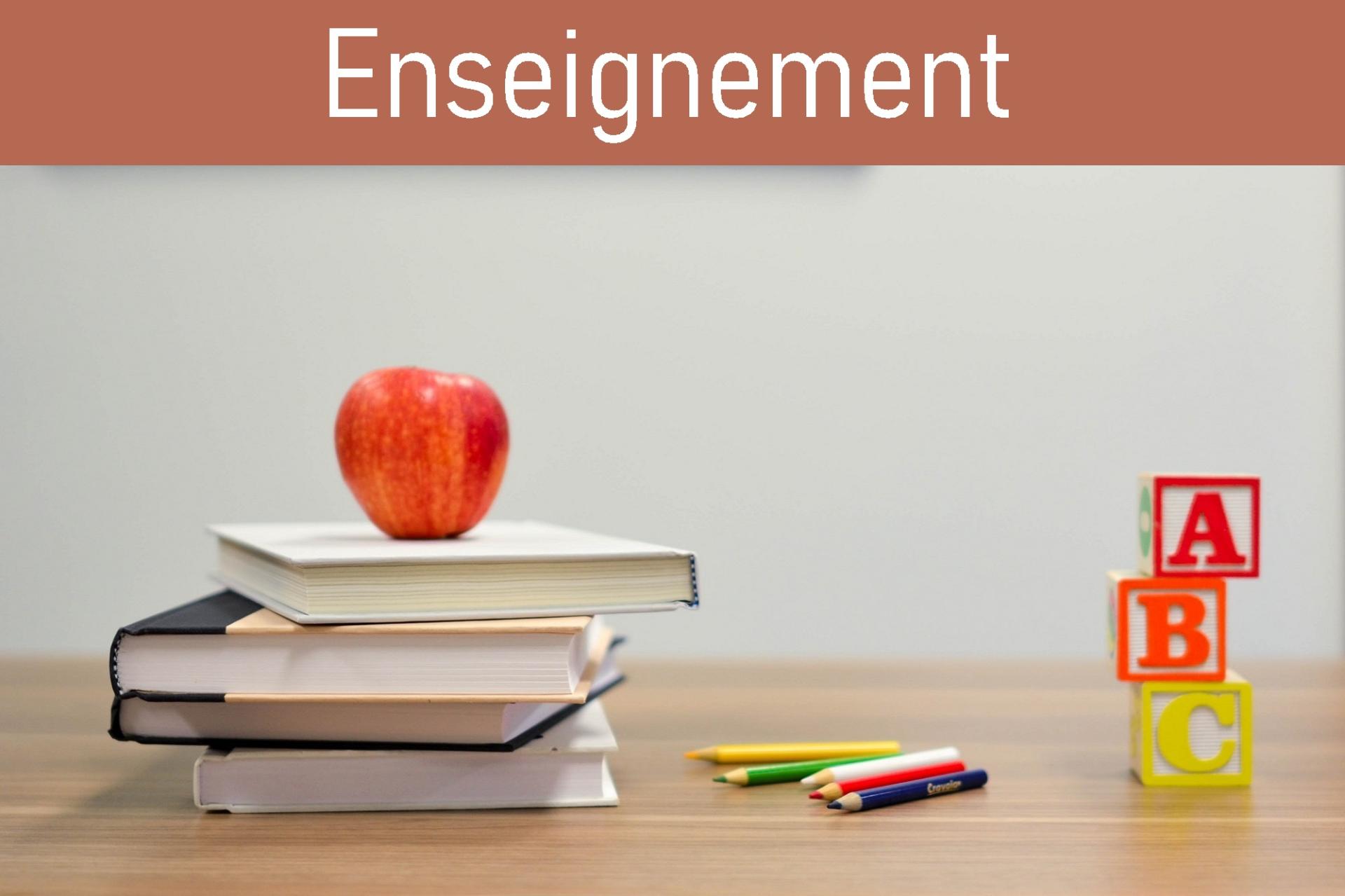
Les litiges avec les établissements scolaires ou le rectorat