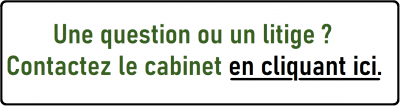La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République a, notamment, eu pour effet de réformer (pour restreindre) l’enseignement dispensé à domicile. Dans la décision commentée, le Conseil d'Etat se penche sur le décret d'application de cette loi.

Le Conseil d’Etat confirme, pour l’essentiel, la réforme de l’enseignement à domicile
Le 08/11/2022
- Le passage d’un régime de déclaration libre à une autorisation dérogatoire
Principalement, l’enseignement à domicile passe, avec cette réforme, d’un régime de « déclaration » à un régime plus contraignant d’« autorisation » (article L. 131-2 du code de l’éducation) pour devenir une « dérogation » au principe de l’enseignement dans les établissements publics ou privés.
De la sorte, l’enseignement dans un établissement scolaire devient un principe et celui de l’instruction à domicile une exception. Ainsi, et même si, dans la pratique, l’immense majorité des enfants était scolarisée, l’enseignement à domicile était considéré, en droit, comme une voie équivalente d’enseignement. Tel n’est plus le cas depuis la réforme.
De plus, l’article L. 131-5 du code de l’éducation dresse désormais une liste limitative des hypothèses dans lesquelles un enfant peut suivre un enseignement à domicile. En effet, jusqu’ici, aucun motif n’avait à être avancé pour permettre un enseignement à domicile. Désormais, les cas dans lesquels l’autorisation peut être obtenue sont limitativement énumérés :
- Son état de santé ou son handicap,
- La pratique d’activités sportives ou artistiques intensives,
- L’itinérance de la famille en France,
- L’éloignement géographique de tout établissement scolaire public,
- L'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif.
Enfin, si une autorisation est accordée, elle ne l’est qu’annuellement aux parents en faisant la demande (sauf dans le cas de l’état de santé de l’enfant ou de son handicap qui peut permettre une autorisation plus longue).
Plusieurs moyens étaient soulevés par deux associations à l’encontre du dispositif, non pas dans ses principes (lesquels ont été validés par le Conseil constitutionnel à l’occasion de sa décision n°2021-823 DC du 13 août 2021), mais de ses modalités pratiques, fixées par le décret n° 2022-182 du 15 février 2022.
En effet, ce décret vient appliquer les principes fixés par la loi nouvelle.
- La période de demande d’autorisation (1er mars - 31 mai) confirmée
Un premier moyen était tiré de la période pour présenter une demande d’autorisation, jugée insuffisante par les requérantes.
Plus précisément, en vertu du nouvel article R. 131-11 du code de l’éducation, les demandes d’autorisation d’instruction à domicile doivent être déposée entre le 1er mars et le 31 mai de l’année scolaire précédant celle de la rentrée.
Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat écarte ce moyen estimant que :
- Ce délai est cohérent avec celui du calendrier d’inscription dans les établissements scolaires,
- N’est pas opposable aux demandes portant sur l’état de santé de l’enfant, son handicap et l’éloignement géographique par rapport à tout établissement scolaire.
Il précise également que, contrairement à ce que soutenaient les associations requérantes (qui estimaient que la possibilité de présenter cette demande à tout moment devait être étendue à tous les motifs de demande d’autorisation d’enseignement à domicile), une telle extension ne serait pas justifiée pour deux raisons :
- D’une part, les autres motifs (pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, itinérance de la famille et « projet éducatif » pour l’enfant) sont des situations prévisibles.
Cet argument, opposé par le Conseil d’Etat, apparaît fondé dans la mesure où, pour ces trois cas d’enseignement à domicile, le projet s’intègre nécessairement dans la durée.
- D’autre part, l’instruction dans un établissement d’enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à « l’intérêt supérieur de l’enfant » dans ces hypothèses.
Cette affirmation de principe apparaît plus critiquable en raison, justement, de son caractère de principe.
En effet, affirmer, par principe, que l’intérêt supérieur de l’enfant ne peut jamais être en cause lorsqu’il est inscrit dans un établissement scolaire et que ses parents souhaitent lui délivrer un enseignement à domicile pour les motifs de pratique d’activités sportives ou artistiques intensives, itinérance de la famille ou « projet éducatif » pour l’enfant, apparaît nécessairement faux.
Plus précisément, au vu de la variété des situations, il est assez discutable que l’intérêt supérieur de l’enfant ne soit jamais en cause dans ces hypothèses.
Et ce, d’autant, qu’une demande d’enseignement à domicile se fonde nécessairement, en vertu de l’article L. 131-5 du code de l’éducation, sur l’intérêt supérieur de l’enfant. Ce qui signifie bien que, parfois, l’intérêt supérieur de l’enfant n’est pas de demeurer dans un établissement scolaire, même quand est en cause l’un des motifs sur lesquels le Conseil d’Etat a statué.
Dès lors, cette affirmation de principe apparaît assez discutable.
Dans ces conditions, il aurait été préférable que le Conseil d’Etat ne se fonde que sur le premier argument.
- L’obligation de produire un justificatif de domicile
Un deuxième moyen avancé par les associations requérantes portait sur le justificatif de domicile qui doit être joint à la demande d’autorisation d’instruction dans la famille. En effet, ces associations affirmaient que les personnes nomades seraient dans l’impossibilité de produire un tel justificatif.
Le Conseil d’Etat écarte ce moyen en indiquant que les personnes sans domicile stable peuvent élire domicile auprès d’un centre communal (CCAS) ou intercommunal (CAIS) d’action sociale ou auprès d’un organisme agréé.
Ce raisonnement apparaît fondé au vu des dispositions applicables. Cependant, il ne peut être nié que, dans la pratique, ces familles rencontreront davantage de difficultés dans la mesure où il faudra, pour elles, demander bien en amont une attestation d'élection de domicile puisque l’administration dispose d’un délai de 2 mois pour répondre à ce type de demandes (et qu’il faudra, pour ces familles, prévoir un délai de sécurité).
- Les demandes d’autorisation pour motifs de santé et l’étude du dossier pas le médecin de l’éducation nationale
Un troisième moyen était dirigé contre le mécanisme mis en place à propos des demandes d’autorisation d’instruction dans la famille pour motifs de santé.
En effet, les associations requérantes affirmaient que le mécanisme mise en place remettait en cause la compétence exclusive de la MDPH pour apprécier le handicap dans la mesure où en matière d’autorisation d’instruction à domicile, c’est le médecin de l’éducation nationale qui rend un avis.
Ce moyen est cependant écarté par le Conseil d’Etat dans la mesure où si la MDPH dispose effectivement d’une compétence exclusive, cette compétence exclusive ne porte que sur l’attribution des droits reconnus par le code de l’action sociale et des familles et le code de la sécurité sociale.
La question de l’autorisation d’instruction dans la famille étant étrangère ces droits, le Conseil d’Etat estime le moyen non-fondé.
Cette position du Conseil d’Etat apparaît d’autant plus justifiée que, d’une part, l’article L. 131-5 du code de l’éducation ne réserve pas l’enseignement dans la famille à la situation de handicap mais plus généralement à l’état de santé de l’enfant, qui n’implique pas nécessairement un handicap et, d’autre part, tous les enfants qui pourraient saisir la MDPH pour la reconnaissance de leur préjudice ne le font pas nécessairement.
- L’organisation du temps de l’enfant et la pratique intensive sportive ou artistique
Les associations requérantes critiquaient, par ailleurs, l’obligation, pour les parents présentant une demande d’autorisation d’instruction dans la famille en raison de la pratique intensive sportive ou artistique, de transmettre avec la demande une présentation de l’organisation du temps de l’enfant, ainsi que ses engagements et ses contraintes, démontrant qu’il ne peut fréquenter un établissement scolaire.
A cet effet, elles affirmaient que les parents n’étaient pas nécessairement dans la capacité de faire une telle présentation de l’organisation du temps de l’enfant.
Cependant, et là encore, le Conseil d’Etat écarte le moyen.
Cette position est plus contestable dans la mesure où, dans ce type d’hypothèse, les parents ne sont pas forcément en mesure de démontrer cette organisation puisque leur connaissance est parfois réduite quant au planning de leurs enfants (puisque ce ne sont pas eux qui fixent les entraînements et les dates compétitions).
Le Conseil d’Etat rappelle, pour écarter ce moyen, que l’enseignement dans la famille reste une dérogation et qu’il appartient donc aux parents de démontrer le caractère intensif de l’activité de leur enfant pour le soustraire à l’obligation d’étudier dans un établissement scolaire.
Cet argument est révélateur du changement d’optique dans lequel, auparavant, l’enseignement à domicile était – en droit – considéré comme un mode d’enseignement comme un autre, alors qu’il est désormais une dérogation au principe de l’inscription dans un établissement scolaire.
- La demande d’autorisation d’instruction à domicile et la « situation propre à l’enfant »
Les associations requérantes critiquaient différents éléments du régime de l’autorisation d’enseignement à domicile tenant à la « situation propre à l'enfant ».
Il convient d’indiquer que ce cas d’enseignement à domicile ne brille pas par sa clarté. En effet, il semble qu’en quelque sorte, il s’agisse d’un motif « voiture-balai » venant permettre de couvrir, éventuellement, les hypothèses non prévues par les cas bien déterminés précédemment.
Ainsi, il est probable que ce cas de demande, qui concentre plusieurs critiques des associations requérantes fasse l’objet de beaucoup de demandes, mais de très peu d’autorisations du fait de son caractère flou qui devra être défini par la jurisprudence à la suite des recours des parents et de leurs avocats en droit de l’éducation.
● Tout d’abord, les associations critiquaient l’obligation de joindre au dossier de demande un projet éducatif écrit, comportant des éléments sur « l’organisation du temps de l’enfant » en affirmant que cela méconnaitrait la « liberté pédagogique ».
Cependant, le Conseil d’Etat écarte cet argument en rappelant qu’il incombe aux autorités administratives de vérifier que l’enfant recevra les éléments essentiels de l’enseignement et de la pédagogie de manière adaptée à son « rythme d’apprentissage » de sorte que cette exigence apparaît justifiée.
● Ensuite, le Conseil d’Etat écarte également l’argument selon lequel l’engagement d’instruire majoritairement l’enfant en langue française méconnaitrait le principe d’égalité en soulignant que cet engagement est prévu par la loi.
De la sorte, le Conseil d’Etat n’examine pas ce moyen puisqu’il oppose ce que l’on appelle la théorie de la « loi écran » (CE. Sect. 6 novembre 1936, Arrighi, Rec.) qui signifie que, dans l’hypothèse où une règle est issue de la loi et non d’un règlement, il n’est pas possible de remettre en cause le règlement (sauf au travers d’une QPC contre la loi elle-même ou en se prévalant de son inconventionnalité).
Or, les requérants ne soulevaient aucun moyen d’inconventionnalité ou d’inconstitutionnalité de la loi (et plus particulièrement de l’article L. 131-5 du code de l’éducation) de sorte que l’argument – même s’il s’avérait fondé – ne pouvait pas être retenu.
Il faut néanmoins souligner que l’argument ne manque pas de pertinence dans la mesure où l’enseignement, majoritairement en français, n’est pas applicable aux établissements privés d’enseignement qui peuvent dispenser un enseignement majoritairement dans une autre langue.
● En outre, les associations requérantes critiquaient l’exigence de présenter, dans le dossier de demande, une copie du baccalauréat ou de son équivalent pour attester de la compétence de la personne censée enseigner le socle commun à l’enfant.
Ce moyen est également écarté par le Conseil d’Etat qui considère que la production de ce diplôme apparaît comme un moyen approprié de contrôler les compétences des personnes vouées à enseigner à l’enfant.
Par ailleurs, il précise que le fait que les titulaires de diplômes étrangers ne bénéficient pas automatiquement d’une équivalence ne méconnaît pas le principe d’égalité dans la mesure où ces derniers sont dans une situation différente. En effet, c’est là l’un des critères du principe d’égalité : pour pouvoir s’en prévaloir, il faut être dans une situation similaire ou identique. Or, le Conseil d’Etat estime que la détention d’un diplôme français ou d’un diplôme étranger n’est pas la même chose de sorte qu’il n’est pas possible de se prévaloir du principe d’égalité.
● Enfin, et toujours à propos du baccalauréat, les associations se prévalaient une nouvelle fois du principe d’égalité.
Elles affirmaient que les dispositions transitoires, qui permettaient aux parents qui enseignaient déjà à leurs enfants avant l’entrée en vigueur de la loi, de continuer à enseigner, même sans baccalauréat, au-delà de cette date pour les seuls enfants auxquels ils enseignaient déjà dès lors que les contrôles réalisés étaient satisfaisants méconnaissait le principe d’égalité entre « enfants d’une même fratrie ».
En effet, le législateur a décidé de ne pas réellement appliquer le régime en vigueur avant la rentrée 2024 aux familles qui enseignaient déjà à leurs enfants en leur donnant une autorisation de « plein droit » pour les deux années scolaires suivantes (à moins que les contrôles réalisés ne soient pas satisfaisants).
Or, les associations requérantes estimaient que ces dispositions transitoires méconnaissaient le « principe d’égalité entre enfants d’une même fratrie » puisque les autres enfants de la famille, dans la même situation, ne pourraient pas étudier avec leurs parents.
Ce moyen est écarté par le Conseil d’Etat dans la mesure où, là encore, cette différence, résulte de la loi. Ce qui signifie qu’il applique la théorie de la « loi-écran » évoquée ci-dessus et qu’il n’examine pas au fond le moyen.
S’il l’avait fait, il l’aurait probablement écarté dans la mesure où il est douteux qu’il reconnaisse un principe d’égalité entre enfants d’une même fratrie à propos de l’évolution des règles en matière d’enseignement. En effet, il est fréquent que les enfants d’une même fratrie soient soumis à des règles différentes en matière d’éducation (programmes, construction des cursus, sélection, etc.). De la sorte, il apparaît inenvisageable de consacrer un tel principe, sauf à bloquer toute évolution du système éducatif à moyen et long terme, ce que le Conseil d’Etat n’accepterait pas.
Ainsi, le Conseil d’Etat écarte tous les moyens relatifs à l’autorisation d’enseignement à domicile tenant à la « situation propre à l'enfant ».
- Le cas particulier des demandes fondées sur le harcèlement de l’enfant
Les associations requérantes abordaient ensuite la question, fondamentale, des demandes d’autorisation d’instruction en famille en cas de harcèlement de l’enfant.
En effet, il n’est malheureusement pas exclu (et pas si rare) que l’enfant ou l’adolescent subisse, dans son établissement scolaire, des menaces contre son « intégrité physique ou morale ».
Cette situation renvoie notamment au cas du harcèlement scolaire, qui peut remettre en cause l’intégrité morale des élèves.
Dans cette hypothèse, la famille peut demander une dérogation au principe de l’enseignement obligatoire en établissement scolaire pour enseigner directement à l’enfant.
C’est alors une demande fondée sur la « situation propre à l'enfant » et la famille doit produire les documents attestant des risques pour l’intégrité de l’enfant.
Dans le cadre de l’instruction d’une telle demande, le directeur de l’établissement d’enseignement émet un « avis circonstancié » sur ce projet.
Les associations requérantes reprochaient au mécanisme de donner au chef d’établissement scolaire un pouvoir d’influer sur la décision. En effet, il est difficilement discutable que l’avis circonstancié rendu par celui-ci sera regardé avec attention par les services instruisant la demande d’autorisation d’instruction dans la famille.
Néanmoins, le Conseil d’Etat estime que l’exigence de cet avis par l’article R. 131-11-7 du code de l’éducation n’est pas entachée d’illégalité dans la mesure où, d’une part, cet avis est utile et, d’autre part, les parents peuvent produire d’autres documents.
- Les modalités du recours préalable obligatoire revues par le Conseil d’Etat
Les associations requérantes adressaient différents reproches au mécanisme de recours préalable obligatoire en cas de refus de l’autorisation d’instruction à domicile.
En effet, il est prévu par les textes qu’en cas de refus d’autorisation d’instruction dans la famille, un recours préalable sera obligatoire déposé (avant toute saisine du juge) auprès d’une commission chargée de réexaminer la décision de refus.
Les associations requérantes soutenaient que le texte méconnaissait le droit au recours dans la mesure où :
- Le délai de saisine de la commission (8 jours) était trop court,
- Le délai donné à la commission pour statuer (1 mois) était trop long.
Le Conseil d’Etat écarte le second argument mais retiens le premier. En effet, il estime que le délai de 8 jours pour saisir la commission est trop court et risque de porter atteinte au droit à un recours effectif.
Aussi, il suspend – dans cette mesure – les dispositions du décret attaqué, tout en précisant que le délai de recours ne devra pas être trop long (pour permettre qu’une décision définitive soit prise avant la rentrée).
Dès lors, il incombera à l’Etat de modifier le décret pour prolonger ce délai de recours.
Cette précision du Conseil d’Etat est intéressante dans la mesure où le délai de 8 jours prévu par le décret en matière de recours contre les refus d’autorisation d’instruction dans la famille est assez courant en matière de droit de l’éducation.
En effet, c’est dans ce délai de 8 jours que doit être contesté une sanction prononcée par le conseil de discipline devant la commission académique (article R. 511-49 du code de l’éducation).
Le délai est même de 3 jours en cas de recours contre un redoublement ou une orientation (articles D. 331-34, D. 331-56 et D. 331-62 du code de l’éducation).
Au vu de la décision rendue en l’espèce par le Conseil d’Etat, l’on peut s’interroger sur la légalité de ces délais très courts prévus par les textes.
De la sorte, cette décision, rendue à propos des autorisations d’instruction à domicile, est susceptible d’avoir un impact sur d’autres domaines du droit de l’éducation.