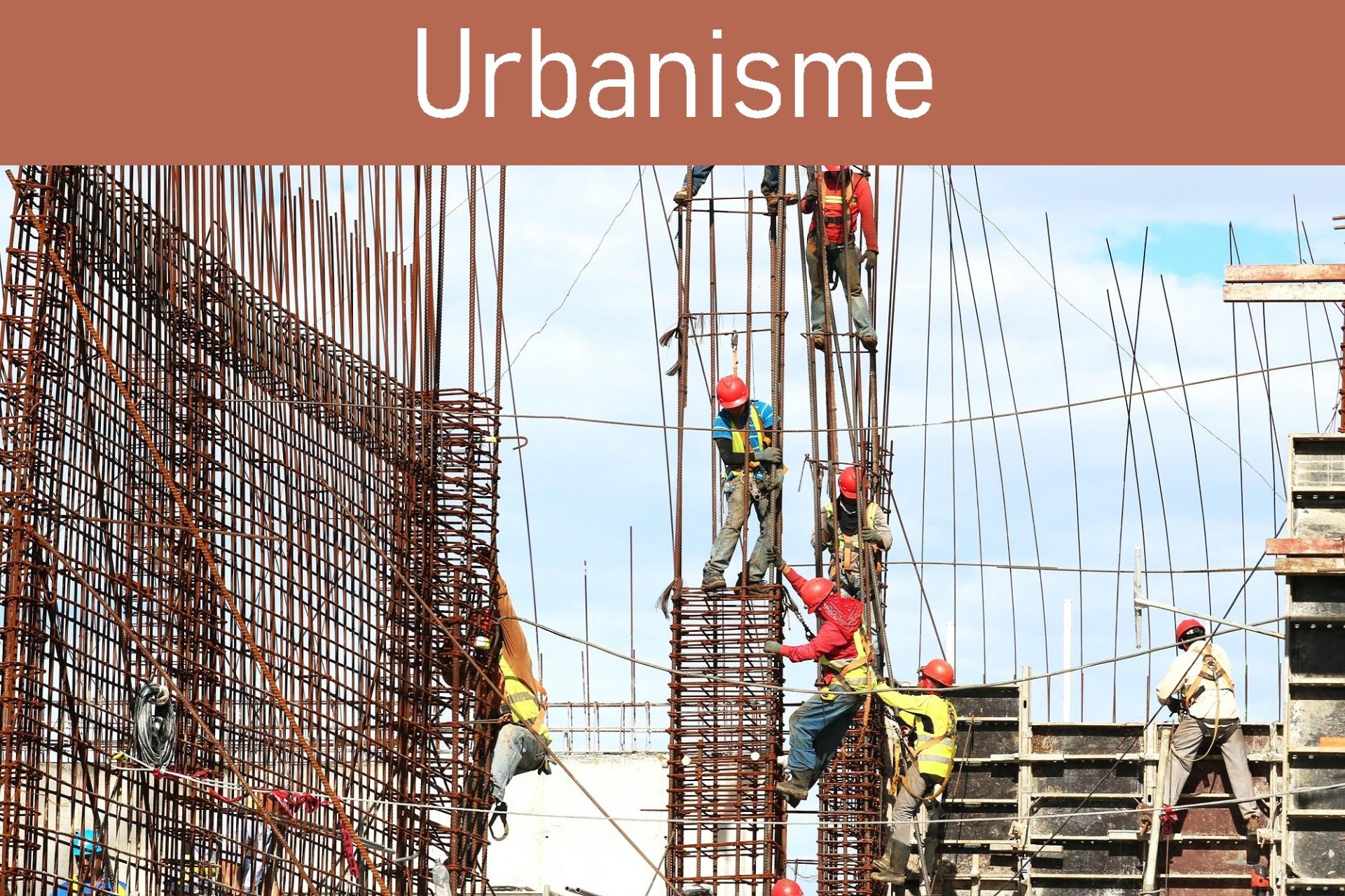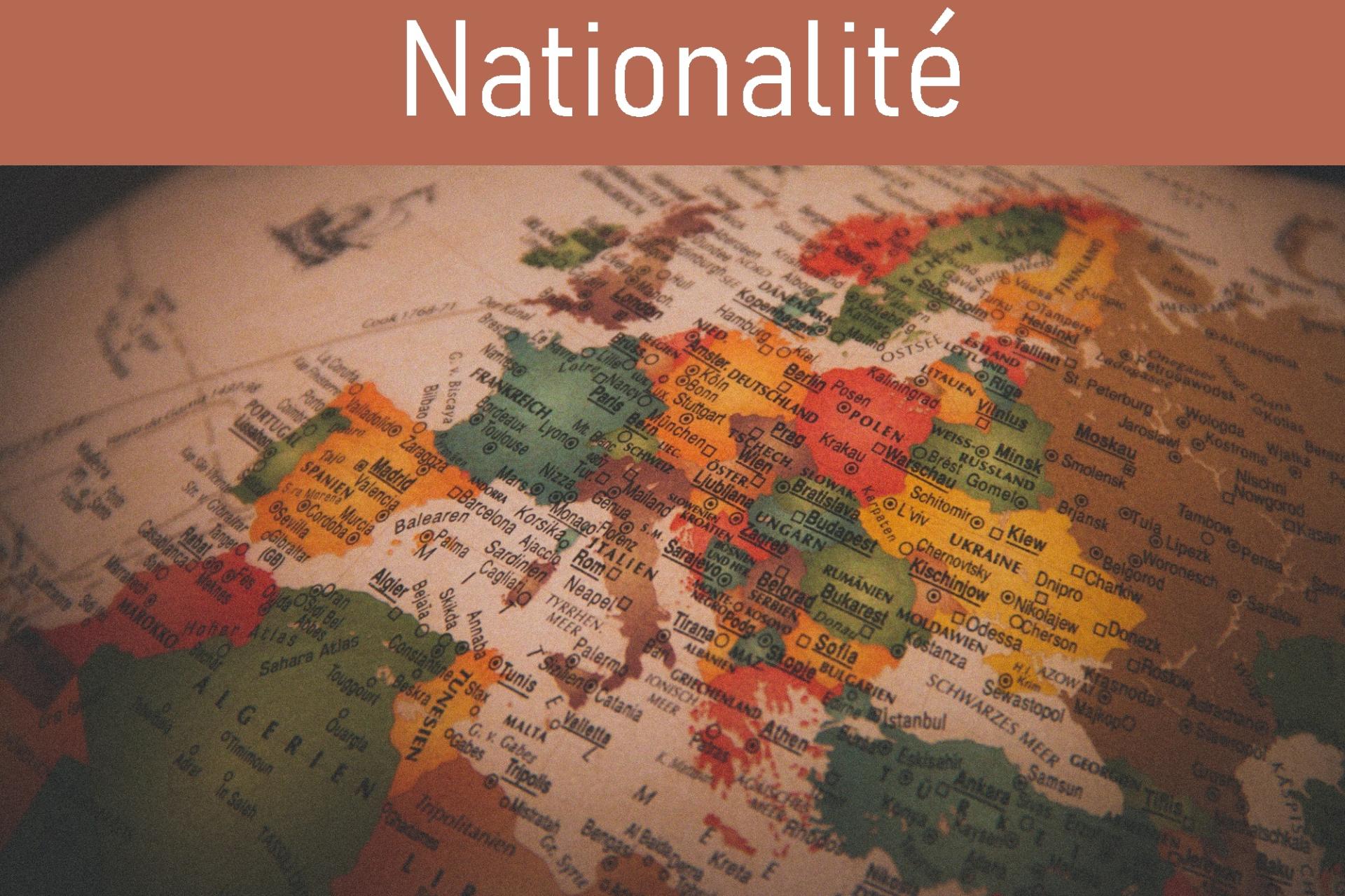Melian Avocats AARPI
Actualités
Le 10/01/2021
Par une décision n° 431994 du 5 juin 2020 le Conseil d’Etat vient préciser les conditions d’appréciation de la covisibilité entre un monument historique et un bâtiment situé dans le rayon de 500 mètres autour de ce monument.
Il est nécessaire de rappeler ici que les travaux réalisés sur les bâtiments situés dans un rayon de 500 mètres autour d’un monument historique sont soumis à avis conforme de l’architecte des bâtiments de France s’ils sont en situation de « covisibilité ».
Dès lors, si un permis de construire est consenti sans cet avis alors que le bâtiment sur lesquels les travaux sont réalisés est situé dans ce périmètre et en covisibilité, alors le permis de construire est illégal.
Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat avait à connaître d’une hypothèse dans laquelle le monument historique et le bâtiment objet des travaux n’étaient pas visibles l’un depuis l’autre mais étaient visibles, tous deux, depuis un autre point.
Cet autre point était cependant situé en dehors du champ de visibilité de 500 mètres et supposait l’utilisation d’un appareil photo en mode zoom.
Le juge des référés du tribunal administratif avait considéré que ces prises de vues étaient suffisantes pour justifier de la covisibilité et suspendre l’exécution du permis de construire au motif que l’architecte des bâtiments de France n’avait pas été consulté.
Toutefois, le Conseil d’Etat suit le raisonnement opposé et apporte d’utiles précisions sur l’appréciation du critère de covisibilité :
- La covisibilité peut être appréciée depuis un autre point, si ce point est normalement accessible au public (autrement dit, la circonstance que les deux bâtiments soient visibles depuis une propriété privée non accessible au public n’est pas de la covisibilité au sens du code du patrimoine).
- Cet autre point peut être situé en dehors du champ de visibilité de 500 mètres autour du monument historique. Le point de vue peut donc être situé en dehors du champ de protection.
- Mais les deux bâtiments doivent être visibles à l’œil nu. Ainsi, il n’est pas possible de tenir compte de la covisibilité s’il est nécessaire d’avoir recours à des jumelles ou à un appareil photographique avec zoom. Autrement dit, le point de vue ne peut pas être situé trop loin.
Dès lors, il considère que, dans le cas d’espèce qui lui est soumis, il n’y avait pas de covisibilité au sens du code du patrimoine.
En effet, il était nécessaire, pour voir les deux bâtiments, de se placer à pris d’un kilomètre et d’utiliser le zoom d’un appareil photographique.
Dans ces conditions, et au vu des principes retenus par le Conseil d’Etat, ce dernier juge qu’il n’était pas nécessaire de consulter l’architecte des bâtiments de France.
Des parcelles construites et bitumées peuvent être inclues dans la zone A (agricole) d’un PLU
Le 30/12/2020
Par une décision n° 429515 du 3 juin 2020, le Conseil d’Etat vient préciser les conditions dans lesquelles des parcelles construites et partiellement bitumées peuvent être classées en zone A (agricole) d’un plan local d’urbanisme (PLU).
● En effet, le Conseil d’Etat considère que les communes (et, après elles, le juge) n’ont pas nécessairement à rechercher si les parcelles sont à usage agricole pour les classer en zone A.
Les communes doivent, selon le Conseil d’Etat, se référer à trois éléments :
- La « vocation du secteur » dans lequel s’insèrent les parcelles (autrement dit l’environnement dans lequel les parcelles sont situées : agricole, urbanisé, etc.),
- Le parti d’urbanisme retenu par la commune (autrement dit la volonté affichée par la commune dans son PLU, par exemple, la préservation ou l’extension des terres agricoles),
- L’existence de « constructions légères et [d’]aménagements d'ampleur limitée » sur ces parcelles (cette précision laisse supposer que si le terrain supporte des constructions importantes par leur ampleur, le terrain ne pourra pas être classé en zone A, même s’il est en plein milieu des champs).
Dès lors, la nature réelle de l’occupation des parcelles n’est que l’un des 3 éléments qui doivent être pris en compte pour apprécier si, oui ou non, elles doivent être classées en zone A du PLU.
Une telle position, si elle n’avait pas été énoncée clairement par le Conseil d’Etat auparavant, ressortait de sa jurisprudence.
Ainsi, il jugeait de manière constante que les auteurs des PLU pouvaient tenir compte « de la situation existante et des perspectives d’avenir » (CE. SSR. 3 novembre 1982, Mlle Bonnaire et a., n° 30396, publiée au Recueil).
De même, dans son contrôle du classement des parcelles dans une zone ou une autre, le Conseil d’Etat tenait compte de l’environnement de ces parcelles (voir, par exemple : CE. SSR. 22 septembre 1997, Commune de Frangy, n° 149191).
Dans ces conditions, la solution retenue ici n’apparaît pas comme révolutionnaire mais elle permet de connaître assez précisément la méthode qu’il convient d’adopter pour classer ou non une parcelle en zone A.
● Appliquant cette solution nouvelle à l’espèce, le Conseil d’Etat considère que la commune de Saint-Nolff pouvait classer en zone A des parcelles partiellement construites et une parcelle artificialisée en quasi-totalité (bitumée en très grande partie).
Pour parvenir à cette conclusion, le Conseil d’Etat retient trois éléments :
- Ces parcelles sont situées en dehors des parties urbanisées de la commune,
- Elles sont en zone très majoritairement agricole,
- Elles disposent d’un potentiel économique en lien avec l’activité agricole (ce faisant, il reconnaît implicitement qu’elles ne peuvent servir à l’agriculture dans la mesure où elles sont construites et artificialisées, mais relève implicitement qu’elles peuvent servir pour la construction de bâtiments agricoles – puisque les bâtiments à usage agricole sont en principe autorisés en zone A).
Dès lors, par cette décision, le Conseil d’Etat confirme la possibilité de classer en zone A des parcelles qui ne sont pas à usage agricole et sont construites.
Le 20/12/2020
Par une décision n° 427781 du 3 juin 2020, le Conseil d’Etat considère qu’un permis de construire, qui impose d’obtenir une servitude de passage pour accéder à la voie publique avant le commencement des travaux, est légal.
Dans cette décision, était en cause un projet de construction de logements sur un terrain qui n’avait pas d’accès à la voie.
Ce projet n’était donc pas conforme à la réglementation en matière d’urbanisme car, pour être constructible, un terrain doit disposer d’un accès à la voie comme le rappellent les plans locaux d’urbanisme (PLU).
Toutefois, plutôt que de rejeter cette demande, le maire de la commune de Fréjus avait fait usage de la possibilité que lui reconnaît le code de l’urbanisme d’assortir son permis de construire d’une prescription (voir l’article : Que sont les prescriptions d’un permis de construire ?) et imposé au demandeur d’obtenir une servitude d’accès à la voie publique avant de commencer les travaux.
En effet, en vertu de l’article 682 du code civil, le propriétaire d’un terrain enclavé peut demander au juge judiciaire d’imposer à ses voisins de lui accorder un passage jusqu’à la voie publique.
Ce permis de construire a été contesté et le tribunal administratif l’a annulé. Le tribunal a retenu que la servitude de passage n’avait pas été obtenue (ni demandée) à la date à laquelle le permis de construire avait été délivré, de sorte que cette prescription ne permettait pas de régulariser le projet.
Ce raisonnement est censuré par le Conseil d’Etat dans la décision commentée.
En effet, il considère que cette prescription permettait de regarder le permis de construire comme conforme aux règles d’urbanisme.
D’une part, il relève explicitement que cette prescription n’entraine pas de modification substantielle du projet (étant précisé qu’une prescription ne peut conduire qu’à modifier des points précis et limités du projet – CE. Sect. 13 mars 2015, n° 358677, publiée au Recueil – voir l’article : Que sont les prescriptions d’un permis de construire ?).
D’autre part, il estime, implicitement qu’il n’est pas nécessaire que la servitude de passage ait été obtenue avant l’octroi du permis de construire.
Comme l’indique la rapporteure publique dans ses conclusions, il s’agit alors d’une autorisation « conditionnelle » possible et, dès lors, légale. L’autorisation ne pourra donc être exécutée qu’une fois la servitude de passage obtenue.
Cette solution – compréhensible sur le plan de l’opportunité – n’en est pas moins étonnante car elle ouvre la voie à l’octroi de permis de construire conditionnels, subordonnés à l’obtention d’autres autorisations.
Toutefois, cette position du Conseil d’Etat ne pourra, très certainement, pas être étendue à d’autres types d’autorisations qui, elles, sont requises par le code de l’urbanisme avant la délivrance d’un permis de construire.
Un recours est irrecevable contre la décision de reconnaître une ZNIEFF ou de la modifier
Le 10/12/2020
Par une décision n° 422182 du 3 juin 2020, le Conseil d’Etat considère que la reconnaissance d’une ZNIEFF ou sa modification ne peut pas faire l’objet d’un recours devant le juge administratif, la reconnaissance d’une ZNIEFF n’ayant par elle-même aucune portée juridique.
Cette solution suppose de rappeler ce qu’est une ZNIEFF et quelles sont les conséquences de sa reconnaissance avant d’examiner la position prise par le Conseil d’Etat.
● Une « zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique » (ZNIEFF) est, comme le rappelle le Conseil d’Etat dans sa décision, un simple inventaire des richesses naturelles (écologiques, faunistiques ou floristiques) d’un territoire.
Cet inventaire est réalisé par le Muséum national d’histoire naturelle.
Il existe deux types de ZNIEFF :
- Les ZNIEFF de type 2 qui sont en général des grands ensembles naturels plus riches que les milieux alentours.
- Les ZNIEFF de type 1 qui sont en principe plus limitées en taille et qui abritent des espèces ou des milieux rares.
De manière schématique, la ZNIEFF de type 1 est plus précieuse d’un point de vue biologique que la ZNIEFF de type 2.
Toutefois, cette classification n’a vocation qu’à permettre de faire un inventaire.
Dès lors, leur reconnaissance n’emporte, en soi, pas de conséquences juridiques propres.
Cependant, dans la pratique, cette reconnaissance a des conséquences importantes puisque l’existence d’une ZNIEFF est un élément qui est pris en compte au titre des législations relatives à l’environnement et à l’urbanisme.
En effet, pour apprécier l’existence d’une zone à protéger et la nécessité, par exemple, de refuser un permis de construire ou une autre autorisation demandée sur le fondement du code de l’urbanisme ou du code de l’environnement, le juge administratif s’intéresse nécessairement à l’existence d’une ZNIEFF.
Cela ne signifie pas que l’existence d’une ZNIEFF suffit à justifier un refus de permis de construire (voir, par exemple : CE. SSR. 15 janvier 1999, Société OMYA, n° 181652) mais sa présence est un élément qui sert parfois à justifier un refus (voir, par exemple : CE. SSR. 3 septembre 2009, Commune du Canet-en-Roussillon, n° 306298, mentionnée aux tables).
Dans ces conditions, si le classement d’un terrain en ZNIEFF n’a pas de conséquence juridique directe, c’est un élément objectif, qui renseigne sur l’intérêt écologique d’une zone et sert donc à l’application pratique des législations sur l’environnement et l’urbanisme.
● Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat avait à se prononcer sur la possibilité de contester la reconnaissance de l’existence d’une ZNIEFF ou du refus de modifier le périmètre de cette ZNIEFF.
En effet, le préfet Corse-du-Sud avait été saisi d’une demande de la commune de Piana tendant à voir le périmètre d’une ZNIEFF réduit. Le préfet ayant refusé cette demande, la commune avait saisi le tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation de ce refus.
Le Conseil d’Etat considère cependant que ce refus ne peut pas être contesté.
Plus précisément, il rappelle qu’une ZNIEFF n’a qu’un objet d’inventaire et n’emporte, par elle-même, aucune conséquence juridique.
Aussi, il n’est pas possible de contester directement la reconnaissance de l’existence d’une ZNIEFF ou sa modification.
Mais cela ne signifie pas pour autant que la délimitation de cette ZNIEFF ou son existence ne peut pas être discutée à l’occasion d’un litige.
En effet, il est possible, lorsqu’une décision a été prise au titre de la législation sur l’environnement ou de l’urbanisme (par exemple un refus de permis de construire), de contester la reconnaissance de la ZNIEFF si l’administration s’est notamment fondée sur l’existence d’une ZNIEFF pour refuser une autorisation.
Cette décision du Conseil d’Etat fixe donc une ligne claire quant aux possibilités de contester l’existence d’une ZNIEFF :
- Pas de recours direct,
- Mais une possibilité de contester lorsqu’une décision se fonde sur l’existence d’une ZNIEFF.
Autrement dit, en matière de permis de construire, il faut attendre qu’un refus soit opposé en se fondant sur l’intérêt écologique du terrain pour contester une ZNIEFF. Il n’est pas possible de demander directement au juge, et préalablement au dépôt d’une demande de permis de construire, de réduire le champ de cette ZNIEFF.
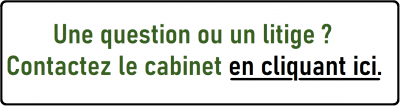
Le retrait de la naturalisation pour fraude ne crée pas d’urgence au sens du référé suspension
Le 30/11/2020
Par une ordonnance n° 440391 du 28 mai 2020, le Conseil d’Etat estime, comme il l’avait fait précédemment, que le retrait d’un décret de naturalisation pour fraude ne crée pas de situation d’urgence.
En effet, dans cette affaire était en cause le retrait d’un décret de naturalisation pour fraude, au motif que la requérante aurait obtenu, antérieurement à sa naturalisation, des titres de séjour par fraude du fait d’une reconnaissance de complaisance.
Face au retrait de son décret de naturalisation, l’intéressée avait formé un référé « suspension » sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui permet, en cas d’urgence, d’obtenir une décision rapide du juge des référés sur la légalité apparente de la décision de l’administration.
Mais dans l’ordonnance commentée, le Conseil d’Etat refuse de se prononcer sur le retrait du décret de naturalisation.
Il estime que, dans la mesure où la décision de retrait de la naturalisation « n'implique pas, par elle-même, que les intéressées soient privées de tout droit au séjour sur le territoire français », il n’y a pas d’urgence à ce qu’il se prononce.
En effet, le retrait de la naturalisation n’empêche pas obligatoirement d’obtenir un titre de séjour même si cela arrive dans certaines hypothèses. Dès lors, le Conseil d’Etat considère que le décret de retrait de la naturalisation ne crée pas de situation d’« urgence » au sens du référé.
Cette position n’est pas nouvelle car le Conseil d’Etat a déjà considéré par le passé que le retrait de la naturalisation ne créait pas de situation d’urgence : CE. Ord. 28 novembre 2017, n° 415482 ; CE. Ord. 5 juillet 2016, n° 400590.
Dès lors, au vu de la réitération de cette position, il faut considérer qu’en principe, le retrait d’un décret de naturalisation ne crée pas de situation d’urgence. De la sorte, il est nécessaire de passer par une procédure au fond (plus longue) pour contester ce retrait.
Cependant, cela ne signifie pas que dans des hypothèses très particulières, l’urgence pourrait être reconnue. Dans l’ordonnance n° 415482 du 28 novembre 2017, le Conseil d’Etat prenait d’ailleurs bien soin de vérifier que la requérante ne devenait pas apatride du fait du retrait de sa naturalisation. Cela laisse donc supposer qu’à l’inverse, si le retrait d’un décret de naturalisation rendait le requérant apatride, cela pourrait conduire à regarder la condition d’urgence comme étant remplie.
L'interdiction de la vente de CBD remise en cause par la CJUE
Le 19/11/2020
Par un arrêt C-663/18 du 19 novembre 2020, la CJUE vient de considérer que l’interdiction de la vente de cannabidiol (CBD) est, en l’état des connaissances scientifiques, injustifiée, mais elle ne ferme pas totalement la porte à une éventuelle interdiction.
● En premier lieu, il convient de rappeler que le CBD, tout comme le tétrahydrocannabinol (THC) dont il se distingue, est un cannabinoïde présent dans le chanvre.
A l’inverse du THC, il n’a pas d’effets psychotropes et n’est, à ce titre, mentionné ni par la Convention unique des Nations unies sur les stupéfiants du 30 mars 1961, ni par la Convention des Nations unies sur les substances psychotropes du 21 février 1971.
D’ailleurs, l’OMS a recommandé, par deux fois, le 18 juillet 2018 et le 24 janvier 2019, de ne plus considérer le CBD comme un stupéfiant en raison de l’absence d’effets nocifs du CBD, constaté par le Comité OMS d’experts de la pharmacodépendance (ECDD).
En effet, le comité ECDD a retenu :
« Cannabidiol (CBD)
Le cannabidiol est l’un des cannabinoïdes naturellement présents dans les plantes de cannabis.
Aucun cas d’abus ou de dépendance n’a été rapporté en relation avec l’utilisation de CBD pur et aucun problème de santé publique n’y a été associé.
On a observé que le CBD est en général bien toléré avec un bon profil d’innocuité. […]
Rien n’indique que le CBD en tant que substance soit susceptible de donner lieu à des abus ou des effets nocifs similaires à ceux des substances inscrites dans les Conventions de 1961 ou de 1971, comme le cannabis ou le THC, respectivement.
Le Comité a recommandé que les préparations considérées comme étant du CBD pur ne soient pas inscrites à un tableau » (pièce n° 1).
C’est la raison pour laquelle l’OMS a proposé à l’ONU les 18 juillet 2018 et 24 janvier 2019 de ne pas l’inscrire dans les conventions internationales sur le contrôle des drogues.
Ainsi, et en l’état des connaissances scientifiques, comme le relève l’OMS, le CBD ne présente « aucun problème de santé publique ».
● En deuxième lieu, et cependant la France interdit – via l’article R. 5132-86 du code de la santé publique et l’arrêté du 22 août 1990 – l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale du CBD.
En effet, ces textes interdisent la commercialisation de la fleur et de la feuille de cannabis Sativa L. Seule la graine et la fibre de cette plante sont autorisées à la vente.
Or, le CBD est extrait des fleurs et feuilles de cannabis, de sorte que cette interdiction de la vente de la fleur et de la feuille, ainsi que des produits qui en sont dérivés, conduit à l’interdiction du CBD en France.
C’est d’ailleurs ce qu’ont rappelé la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives (Mildeca) le 11 juin 2018 en faisant un « point sur la législation » en matière de CBD et le ministère de la justice le 23 juillet 2018.
Dès lors, l’interdiction en vigueur ne fait aucun doute.
Malgré cela, au cours des dernières années le commerce de produits à base de CBD s’est développé partout en Europe et notamment en France.
● En troisième lieu, cette situation a donné lieu à différentes fermetures administratives et poursuites pénales des gérants de magasins vendant du CBD.
Or, à l’occasion de l’une de ces poursuites, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a posé, le 23 octobre 2018, une question préjudicielle à la CJUE pour qu’elle se prononce sur la conformité de l’interdiction prévue en France avec le droit de l’Union européenne.
L’avocat général amené à présenter ses conclusions le 14 mai 2020 sur cette affaire C-663/18 a confirmé le raisonnement de l’OMS, à savoir qu’il n’existe à ce jour aucun risque (psychotrope notamment) établi à l’égard du CBD. C’est la raison pour laquelle il a invité la Cour à juger que :
- La réglementation française, qui interdit l’importation de produits à base de CBD extraits de l’intégralité de la plante (fleur et feuille inclues, et non pas seulement graine et fibre), est contraire aux articles 34 et 36 du TFUE dans la mesure où il n’existe aucun effet nocif démontré ;
- Des restrictions à la commercialisation de produits à base de CBD pourraient éventuellement être imposées si l’Etat démontrait l’existence de risques (non identifiés à l’heure actuelle) pour la santé.
● En quatrième lieu, l’arrêt de la CJUE était donc attendu au vu de ses impacts sur de nombreux litiges en cours et sur la vente de CBD.
Cet arrêt vient d’être rendu par la Cour et il est sans surprise (étant donné les conclusions de l’avocat général).
Dans un premier temps, la Cour considère que le CBD n’est pas un stupéfiant et n’apparaît pas – en l’état des connaissances scientifiques – avoir un effet psychotrope ou nocif pour la santé. Aussi, elle estime que l’interdiction de la commercialisation en France de ce produit est contraire au droit de l’Union européenne (plus précisément à la liberté de circulation des marchandises).
Dans un second temps, et cependant, elle estime qu’une interdiction pourrait être justifiée par un motif d’intérêt général (ici la protection de la santé publique). Elle relève deux choses mais ne se prononce pas sur le fond (car ce sont les juridictions françaises qui auront à se prononcer) :
- D’une part, il semble à la Cour que le CBD de synthèse n’est pas interdit en France, ce qui montre l’incohérence de la réglementation française.
- D’autre part, si l’Etat n’est pas tenu de démontrer que le CBD est aussi dangereux que les stupéfiants pour, éventuellement, l’interdire, il faut qu’il démontre que les risques allégués ne sont pas purement hypothétiques et sont suffisamment établis.
Telle est donc la position retenue par la Cour.
Cet arrêt ne tranche donc pas définitivement la question puisqu’il renvoie l’affaire aux juridictions françaises. Mais la Cour relève qu’en l’état des connaissances scientifiques, aucun risque n’est identifié. Elle invite donc – implicitement – les juridictions françaises à censurer les textes français.
En effet, si l’Etat n’a pas été capable de produire devant la CJUE d’études scientifiques démontrant la supposée dangerosité du CBD, il est probable qu’il n’y parvienne pas devant les juridictions internes.
Mais, le feuilleton judiciaire relatif à la vente de CBD n’est pas encore terminé.
Et ce, d’autant que la Cour de cassation doit se prononcer sur cette question (Cass. Crim. 14 mai 2019, n° 18-86932), tout comme le Conseil d’Etat qui est saisi d’une demande d’annulation de l’interdiction en France.
Ainsi, un certain nombre de décisions sont encore attendues sur ce sujet.
Le 16/11/2020
Par une décision n° 433608 du 27 mai 2020, le Conseil d’Etat juge que tous les riverains d’une voie privée ouverte à la circulation publique ont intérêt à agir contre le refus de transférer cette voie dans le domaine public communal.
Cette utile précision du Conseil d’Etat suppose de rappeler ce qu’est le mécanisme de transfert de la propriété de la voie, son utilité et ses conditions.
● Le transfert des voies privées ouvertes à la circulation publique prévu par l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme permet un transfert (sans expropriation) d’une propriété privée vers une propriété publique.
Elle vise à prendre acte d’une situation de fait, à savoir l’ouverture d’une voie à tous, pour conduire à son transfert d’un propriétaire privé vers un propriétaire public.
Mais bien entendu, ce transfert ne peut avoir lieu si, avant le terme de la procédure de transfert, le propriétaire de la voie renonce à laisser cette voie libre et en ferme l’accès (CE. SSR. 17 juin 2015, Commune de Noisy-le-Grand, n° 373187, mentionnée aux tables).
Ainsi, le propriétaire peut, de fait, toujours s’opposer au transfert.
● L’utilité principale de cette procédure est de transférer la charge de l’entretien de ces voies et de permettre à la collectivité d’y effectuer des travaux et de gérer ce bien qui intègre le domaine public.
En effet, une voie doit en principe être entretenue par le son propriétaire.
Dans ces conditions, l’entretien de la voie incombe normalement au propriétaire privé de la voie, même si elle est ouverte à la circulation publique. La commune peut d’ailleurs dans ce cas imposer au propriétaire négligeant de faire des travaux d’entretien de ces voies privées ouvertes (CAA Marseille, 10 décembre 2009, Commune de Sainte-Maxime, n° 08MA01875).
Il n’en va différemment que si la commune décide d’entretenir cette voie privée même si elle ne lui appartient pas. En effet, il arrive parfois que des voies privées soient, de fait et par commodité, entretenues par une commune pour assurer la sécurité des riverains. Si elle le fait, la commune n’a d’autre choix que de continuer car, à défaut, elle peut voir sa responsabilité engagée (CE. Sect. 18 mai 1973, Ville de Paris, n° 82672, publiée au Recueil ; CE. SSR. 9 février 1977, Ville de Limoges, n° 99756, mentionnée aux tables ; CE. SSR. 19 octobre 1979, Société Difamelec, n° 05858, mentionnée aux tables ; CE. SSR. 30 novembre 1979, Ville de Joeuf, n° 02651, mentionnée aux tables).
Le transfert de propriété de la voie privée ouverte à la circulation publique transfert donc en principe la charge de l’entretien (sauf si la commune entretient déjà la voie). De la sorte, le propriétaire privé est libéré de son obligation d’entretenir la voie (CAA Marseille, 9 juillet 2012, M. Gustave A, n° 11MA02796).
Ce transfert assure également une protection à la voie.
En effet, une fois transférée dans le domaine public, elle devient inaliénable et doit faire l’objet d’une autorisation avant toute occupation. C’est donc une garantie pour les riverains et les passants qui sont assurés de pouvoir continuer à utiliser cette voie.
● La condition principale posée à ce transfert est l’ouverture à la « circulation publique ».
Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’Etat rappelle que la circulation publique ne se réduit pas à la circulation automobile. En effet, un chemin piétonnier est regardé comme étant ouvert à la « circulation publique ».
Différentes cours administratives d’appel ont eu l’occasion de l’indiquer par le passé (voir, par exemple : CAA Paris, 12 juillet 2010, Mme Jourdan, n° 10PA00365 ; CAA Lyon, 31 mai 2011, Commune d’Aix-les-Bains, n° 09LY02935) et c’est ce qu’avait jugé la cour administrative d’appel de Nantes dans l’arrêt contesté devant le Conseil d’Etat (CAA Nantes, 18 juin 2019, Consorts A et SSCV les Viviers, n° 18NT00294).
Ainsi, le Conseil d’Etat considère qu’une voie peut être regardée comme ouverte à la circulation publique, même si les automobiles y sont interdites. Le passage des piétons suffit à faire regarder une voie comme étant ouverte à la circulation publique.
● Mais l’apport principal de la décision du Conseil d’Etat tient à la possibilité qu’il offre aux riverains de contester le refus de transfert d’une voie privée ouverte à la circulation publique vers une voie publique.
En effet, jusqu’ici la jurisprudence laissait plutôt supposer que seuls les propriétaires de la voie pouvaient contester le refus de transfert de leur voie à la commune.
La cour administrative d’appel de Lyon avait d’ailleurs expressément jugé :
« Considérant […] que s'il est loisible à tout habitant de la commune de solliciter le transfert d'une voie dans le domaine public, les personnes dépourvues d'un droit de propriété sur cette voie ne peuvent se prévaloir d'un intérêt leur permettant de contester devant le juge administratif le refus de mettre en oeuvre la procédure de transfert d'office sans indemnité » (CAA Lyon, 21 juin 2012, M. Muller, n° 11LY00363).
Le principe paraissait donc être qu’en cas de refus de transfert de la voie par l’autorité publique, seul le propriétaire de cette voie pouvait contester ce refus. En revanche, les riverains de la voie, même s’ils en avaient l’usage, ne pouvaient pas contester ce refus.
Par la décision commentée, le Conseil d’Etat prend cependant le contre-pied de cette position. En effet, il juge :
« 5. Le transfert d'une voie privée ouverte à la circulation publique dans le domaine public communal ayant notamment pour effet de ne plus faire dépendre le maintien de l'ouverture à la circulation publique de la voie du seul consentement de ses propriétaires et de mettre son entretien à la charge de la commune, les riverains de la voie justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation […] ».
Il estime ainsi que les riverains, qui sont dépendants de l’autorisation du propriétaire de la voie privée pour l’utiliser, ont intérêt à contester le refus de transférer cette voie dans le domaine public.
Cette solution apparaît logique dans la mesure où il ne peut être nié que le transfert de la voie dans le domaine public a une importance pour les riverains. En effet, la qualification de voie publique assure un accès certain à la voie.
Dès lors, cela signifie désormais que les riverains d’une voie privée ouverte à la circulation publique pourront demander l’intégration de cette voie à la voirie publique et contester l’éventuel refus qui leur sera opposé.
Le 01/07/2020
Par une décision n° 418178 du 6 novembre 2019, le Conseil d’Etat apporte d’utiles précisions sur le régime de la des radiations des cadres prononcées à l’encontre des fonctionnaires exerçant dans un établissement scolaire en cas de une condamnation pour crime ou délit contraire aux mœurs, sans pour autant lever les doutes quant à la procédure applicable à ces décisions.
En effet, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L. 911-5 du code de l’éducation, il n’est pas possible d’être employé dans un établissement scolaire si l’on a été condamné pour un « crime ou délit contraire à la probité et aux mœurs ».
Dès lors, si le fonctionnaire est condamné au cours de sa carrière, il doit être radié des cadres. Cette condition primordiale à son employabilité n’étant plus remplie, il ne peut être maintenu dans les effectifs.
Toutefois, la nature exacte de cette décision et le régime auquel elle est soumise demeurent partiellement indéfinis.
- Concernant sa nature, la décision commentée apporte d’utiles précisions
En effet, la décision commentée, telle qu’éclairée par les conclusions du rapporteur public Raphaël Chambon, tranche la qualification de la décision de radiation des cadres prise en raison d’une telle condamnation.
1. Le Conseil d’Etat considère qu’il s’agit d’une décision recognitive et non d’une décision prise en vertu d’une compétence liée.
Cette précision, qui peut paraître purement technique de prime abord a en réalité une importance non négligeable puisqu’elle détermine les moyens qu’il sera possible de soulever contre la décision de radiation des cadres du fonctionnaire. En effet, ces deux types de décisions se distinguent :
- Les décisions recognitives se « bornent à constater » une situation qui préexiste (comme le rappelle Raphaël Chambon dans ses conclusions).
- Les décisions prises dans le cadre d’une compétence liée sont celles adoptées lorsque l’administration n’a aucun choix et aucune marge d’appréciation sur la conduite à tenir (CE. Sect. 3 février 1999, M. Montaignac, n° 149722, publiée au Recueil).
Comme le souligne Raphaël Chambon dans ses conclusions, la jurisprudence antérieure du Conseil d’Etat était contradictoire sur ce point, certaines décisions considérant que ce type de radiation des cadres est une compétence liée (CE 17 juin 1960, Baudot, p. 405 ; CE. SSR. 22 mars 1999, Georges Q, n° 191393, publiée au Recueil) tandis que d’autres ont jugé qu’il s’agissait d’un décision recognitive (CE. SSR. 22 avril 1992, Jacky Y, n° 99671, mentionnée aux tables ; CE. SSR. 21 avril 2000, Patrick G, n° 197388, mentionnée aux tables).
Cette divergence se retrouve d’ailleurs assez logiquement dans la jurisprudence des juridictions du fond, comme cela était indiqué dans un précédent commentaire La condamnation pour crime ou délit contraire aux moeurs d'un agent exerçant dans un établissement scolaire (pour des arrêts retenant la compétence liée : CAA Versailles, 2 novembre 2006, n° 05VE00120 ; CAA Bordeaux, 8 mars 2011, n° 10BX01886 ; pour un arrêt retenant le caractère recognitif : CAA Paris, 3 avril 2014, n° 13PA00415).
Dans la décision commentée, sur proposition du rapporteur public Raphaël Chambon, le Conseil d’Etat retient que ce type de décision est une décision recognitive.
Autrement dit, il estime que dans cette hypothèse, l’administration se borne à constater, par la radiation des cadres, la disparition d’un lien qui n’existe déjà plus.
En effet, comme le fonctionnaire ne remplit plus, dès sa condamnation, une condition essentielle de son employabilité, le lien est – virtuellement – rompu dès cette condamnation.
La décision de radiation des cadres du fonctionnaire ne fait donc que « tirer les conséquences » de cette incapacité.
2. Le Conseil d’Etat en déduit qu’en l’espèce, la décision de radiation des cadres pouvait légalement être rétroactive.
La radiation du fonctionnaire avait eu lieu le 3 mars 2015 mais prenait effet à la date de la condamnation définitive (soit le 29 octobre 2014). C’est ce que critiquait le fonctionnaire radié et la cour administrative d’appel lui avait donné raison.
En effet, il est jugé de manière constante qu’en principe un acte réglementaire ne peut pas être rétroactif. Autrement dit, il ne peut pas réglementer le passé (CE. Ass. 25 juin 1948, SARL du journal « L’Aurore », n° 94511, publiée au Recueil).
Toutefois, ce principe connaît des limites et notamment pour les décisions recognitives.
Comme ces décisions sont regardées comme ne faisant que prendre acte d’une situation préexistante, elles peuvent légalement réglementer le passé.
Dès lors, en l’espèce, le Conseil d’Etat censure l’arrêt de la cour et juge que la décision de radiation du fonctionnaire pouvait prendre effet à une date antérieure à son édiction (ce qui a pour conséquence pratique d’imposer le reversement par le fonctionnaire des salaires qu’il a perçus dans l’intervalle).
- Concernant son régime, la décision commentée laisse le débat ouvert
Comme l’indiquait le commentaire précédent, la question des moyens qui peuvent être soulevés à l’encontre de ces décisions de radiation des cadres reste en suspens.
En effet, il est désormais clair (sous réserve d’un nouveau revirement de jurisprudence) que les décisions de radiation des cadres prises à la suite d’une condamnation pour un crime ou délit contraire aux bonnes mœurs sont des décisions recognitives.
Les conclusions de Raphaël Chambon apportent d’utiles précisions sur le raisonnement en deux temps de l’administration :
- Dans un premier temps, elle porte une appréciation sur la nature de la condamnation, pour déterminer si elle est contraire à la probité ou aux bonnes mœurs.
- Dans un second temps, elle prend la décision recognitive de radiation des cadres dans laquelle elle tire les conséquences de l’incapacité.
Mais il n’est toujours pas déterminé avec clarté si le premier temps de la décision suppose la motivation de la décision et la communication du dossier à l’agent.
C’est ce qu’avait jugé la cour administrative d’appel de Paris dans deux arrêts (CAA Paris, 24 septembre 2013, n° 11PA05024 ; CAA Paris, 3 avril 2014, n° 13PA00415), en estimant que – même recognitive – la décision était en décision défavorable prise en considération de la personne puisqu’elle conduisait à la radiation de l’agent. Elle en a déduit que la qualification de condamnation contraire à la probité ou aux bonnes mœurs ne pouvait intervenir sans communication préalable de son dossier à l’agent et sans motivation de la qualification de condamnation « contraire à la probité et aux mœurs ».
Cette position apparaît logique dans la mesure où si le raisonnement débouche sur une décision recognitive, la première partie du raisonnement est, quant à elle, une qualification classique et constitue un acte défavorable à l’agent.
Toutefois, cette solution n’est confirmée ni par la décision du Conseil d’Etat (mais cette question ne lui était pas soumise) ni par les conclusions du rapporteur public qui n’abordent pas ce point.
Il est donc probable que la radiation des cadres pour la condamnation d’un fonctionnaire pour un crime ou délit « contraire à la probité et aux mœurs » continue à donner lieu à des litiges soumis au Conseil d’Etat.
Le 15/06/2020
Une décision n° 412440 du 8 novembre 2019 du Conseil d’Etat met en exergue l’importance du libellé des décisions de la CDAPH.
1. En effet, dans cette affaire, était en cause le défaut de scolarisation d’une jeune fille en situation de handicap pendant deux ans.
Tout d’abord scolarisée à l’institut régional de jeunes sourds de Poitiers, elle avait ensuite été orientée par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) vers un parcours en « établissement d'éducation sensorielle pour déficients auditifs » mais sans que la décision de la CDAPH ne désigne d’établissement déterminé.
Les parents de cette enfant n’avaient alors pas pu l’inscrire, pendant deux ans, de sorte qu’elle avait été déscolarisée.
Ils ont donc recherché la responsabilité de l’Etat du fait de cette situation en raison de son obligation de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer de manière effective le droit à l’éducation et l’obligation scolaire pour les enfants atteints de handicap.
2. En effet, il convient de rappeler que l’Etat a l’obligation d’assurer la scolarisation des enfants atteints de handicap au même titre que les autres enfants, sans qu’il puisse se prévaloir de l’insuffisance des places disponibles (voir sur ce point : L'Etat est responsable de l'absence de place adaptée pour un enfant handicapé).
Il est désormais jugé de manière claire que les difficultés rencontrées par ces enfants et le manque de places dans des structures adaptées (CE. SSR. 8 avril 2009, n° 311434, publiée au Recueil) ne peut justifier leur absence de scolarisation.
Il a également été précisé que la responsabilité de l’Etat pour sa carence est engagée dans l’hypothèse où la CDAPH ne prend pas de décision d’orientation à l’égard d’un enfant lorsque cette absence de décision de la CDAPH est fondée sur l’insuffisance des structures d’accueil (CE. SSJS. 29 décembre 2014, n° 371707).
3. Toutefois, dans la décision commentée, et malgré l’absence de scolarisation de l’enfant pendant deux ans, le Conseil d’Etat écarte la responsabilité de l’Etat.
Pour cela, il se fonde sur deux éléments :
- D’une part, il estime que l’Etat ne peut voir sa responsabilité engagée du fait des décisions prises par la CDAPH au nom de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH).
- D’autre part, il relève que, dans cette affaire, la CDAPH s’était abstenue de désigner un établissement adapté aux besoins de l’enfant en l’orientant vers un parcours en « établissement d'éducation sensorielle pour déficients auditifs ».
Dans ces conditions, il estime que l’absence de scolarisation de l’enfant n’est pas due à une carence de l’Etat mais à une insuffisance de la décision de la CDAPH, dont il n’est pas responsable.
Le Conseil d’Etat va d’ailleurs plus loin en considérant que l’Etat :
- N’avait pas la compétence pour orienter l’enfant vers un établissement ou un service donné,
- N’avait pas la compétence pour imposer l’inscription d’un enfant à un établissement tel que l'Institut régional de jeunes sourds de Poitiers (qui est un établissement géré par une association et non par les pouvoirs publics, bien qu’il soit en charge d’un service public).
Autrement dit, la compétence dévolue à la CDAPH par les articles L. 351-1 et 351-2 du code de l’éducation pour l’orientation des enfants atteints de handicap et la désignation des établissements est exclusive. De sorte que l’Etat ne peut pas se substituer à la CDAPH en cas d’un insuffisant exercice de sa compétence.
Cette affirmation est quelque peu contradictoire avec l’affirmation de principe rappelée par le Conseil d’Etat au début de sa décision selon laquelle « il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ».
Ainsi, il y a donc en réalité une limite à cette obligation générale de l’Etat, à savoir les compétences qu’il a décidé de confier à d’autres autorités.
4. Dès lors, cette affaire montre l’importance de la rédaction des décisions de la CDAPH.
En effet, celle-ci doit bien prendre soin de désigner les établissements susceptibles de recevoir l’enfant en vertu de l’article L. 351-2 du code de l’éducation, ou d’indiquer qu’elle ne désigne aucun établissement en l’absence de place disponibles.
A défaut, l’Etat pourra rejeter, comme en l’espèce, la responsabilité de l’absence de scolarisation sur la CDAPH dont la responsabilité ne relève pas – comme l’indique ici le Conseil d’Etat – de la compétence du juge administratif, mais du juge judiciaire.
Le Conseil d’Etat précise les différentes possibilités de suspension des PUPH
Le 01/06/2020
Par une décision n° 422922 du 5 février 2020, le Conseil d’Etat a eu l’occasion de rappeler et de préciser les pouvoirs de suspension dont disposent l’université, le centre hospitalier, l’ARS et les ministres de tutelle à l’égard des professeurs des universités - praticiens hospitaliers (PUPH).
En effet, les PUPH, comme tous les fonctionnaires (voir l’article La suspension dans la fonction publique), peuvent faire l’objet d’une suspension à titre conservatoire. Mais la spécificité de leurs fonctions, à la fois médicales et universitaires les placent dans une situation particulière et sous l’autorité de plusieurs administrations.
Dans l’affaire dont a eu à connaître le Conseil d’Etat, était en cause une PUPH accusée par de nombreux collègues d’un harcèlement moral à l’originee d’une dégradation des conditions de travail et des activités universitaires.
Après un rapport de l’inspection générale sur son comportement, l’intéressée avait fait l’objet de plusieurs suspensions de fonctions :
- Celle du président de l’université pour ses fonctions universitaires,
- Celle du directeur du centre hospitalier pour ses fonctions médicales,
- Celle prononcée conjointement par les ministres de l’éducation et de la santé.
Ces trois décisions ont été contestées par la PUPH. In fine, seule l’une de ces décisions est annulée. Mais cette décision est surtout l’occasion pour le Conseil d’Etat de rappeler les conditions dans lesquelles peut intervenir la suspension d’un PUPH et la réparation des compétences entre les différentes autorités.
- La suspension par l’université
La suspension peut tout d’abord intervenir sur les fonctions universitaires du PUPH. Cela n’affecte pas en principe ses activités médicales mais uniquement ses fonctions d’enseignement.
Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat rappelle que cette suspension peut intervenir sur le fondement de l’article L. 951-4 du code de l’éducation à deux conditions cumulatives :
- Que les faits imputés à l’agent aient un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant (CE. SSR. 10 décembre 2014, n° 363202, mentionnée aux tables ; CE. CHS. 24 décembre 2019, n° 428099 – voir le commentaire). Il s’agit là d’une simple transposition de la condition posée par l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983 dans le silence des textes.
- Que la poursuite des activités de cet agent au sein de l’établissement présente des inconvénients « suffisamment sérieux » pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours (CE. CHR. 30 mai 2018, n° 418844 ; CE. CHR. 18 juillet 2018, n° 418844, publiée au Recueil).
Ainsi, à la différence des autres fonctionnaires, il ne suffit pas que les faits imputés au fonctionnaire soient suffisamment vraisemblables et graves, il faut également qu’ils perturbent le service.
- La suspension par l’ARS
L’agence régionale de santé (ARS) peut également suspendre, en cas d’urgence, sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, l’autorisation d’exercer d’un PUPH dans l’hypothèse où il expose ses patients à un danger grave.
Ce type de suspension n’a donc rien à voir avec le caractère fautif du comportement d’un PUPH à l’égard, par exemple, de ses collègues.
Cette suspension est tournée vers la santé des patients et uniquement vers elle. Ce n’est que quand ces derniers sont face à un grave danger constitué par le médecin en cause que l’ARS peut suspendre en urgence l’autorisation d’exercer du médecin.
- La suspension par les ministres de tutelle
Comme cela ressort des développements qui précèdent, un PUPH peut, d’une part, faire l’objet d’une suspension de ses fonctions universitaires, comme tout autre fonctionnaire dans l’attente d’une procédure disciplinaire et, d’autre part, être suspendu de ses fonctions médicales par l’ARS si son exercice fait peser un grave danger sur ses patients.
En plus de ces textes généraux qui s’appliquent, pour les premiers, à tous les membres de l’enseignement supérieur et, pour les seconds, à tous les médecins, il existe un texte spécifique pour les PUPH.
En effet, l’article 25 du décret n° 84-135 du 24 février 1984 prévoit également une possibilité de suspension, cette fois générale, de l’ensemble des fonctions d’un PUPH en cas de procédure disciplinaire à son encontre.
Dans cette hypothèse, les ministres de l’éducation et de la santé peuvent décider de suspendre le PUPH si « l'intérêt du service l'exige ».
Ainsi, dans ce cas, la suspension est encore soumise à des conditions différentes, qui sont les suivantes :
- L’agent doit faire l’objet d’une procédure disciplinaire.
- L’intérêt du service exige sa suspension. Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat estime que la « profonde dégradation des conditions de travail » justifie l’intérêt du service de cette suspension.
- Il n’est pas certain qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence d’une faute suffisamment grave et vraisemblable. En effet, cette condition est généralement exigée (CE. SSR. 10 décembre 2014, n° 363202, mentionnée aux tables) et le Conseil d’Etat en a déjà fait application pour la suspension mentionnée à l’article 25 du décret du 24 février 1984 (CE SSR. 15 décembre 2000, M. X et Syndicat des professeurs hospitalo-universitaires, n° 194807, publiée au Recueil). Mais il ne la reprend pas expressément dans la décision commentée. L’on peut donc s’interroger sur sa pérennité (même si sa disparition ne paraitrait pas conforme à l’esprit de sa jurisprudence).
Dans ce type d’hypothèse, les ministres peuvent suspendre le PUPH.
- La suspension par la direction du centre hospitalier
Une quatrième et dernière possibilité de suspension est prévue par la jurisprudence.
En effet, le Conseil d’Etat a considéré de longue date que le centre hospitalier pour lequel travaille le médecin peut, même sans texte, le suspendre (CE. SSR. 4 janvier 1995, CHG de Bagnols-sur-Cèze, n° 128490, mentionnée aux tables ; CE SSR. 15 décembre 2000, M. X et Syndicat des professeurs hospitalo-universitaires, n° 194807, publiée au Recueil).
La reconnaissance de ce pouvoir n’a, en soi, rien de surprenant car l’administration dispose de nombreux pouvoir, même sans texte, pour prendre des mesures conservatoires de protection du service ou des usagers dans l’attente d’une sanction (CAA Lyon, 18 mars 2014, M. D c. France Télécom, n° 13LY00275 ; CAA Paris, 26 juin 2007, Mme Froidurot, n° 05PA01294 ; CAA Versailles, 14 mars 2006, M. Souleymane Toure, n° 03VE02879 ; CAA Paris, 28 décembre 2005, Mme Gonnet, n° 02PA02984).
Toutefois, au cas présent, ce pouvoir est soumis à des conditions très strictes précisées dans la décision commentée. En effet, le Conseil d’Etat indique que ce pouvoir de suspension reconnu sans texte ne peut être mis en œuvre que dans des « circonstances exceptionnelles ».
Autrement dit, ce type de suspension ne peut intervenir que dans des hypothèses extrêmement limitées. Le Conseil d’Etat pose trois conditions cumulatives à cette suspension :
- Une mise en péril imminente de la continuité du service,
- Une mise en péril imminente de la sécurité des patients,
- Une information immédiate des autorités de nomination (autrement dit des ministres).
Ainsi, ce type de suspension ne peut être mis en œuvre qu’en cas d’extrême urgence, si un médecin constitue un réel danger et qu’il n’est pas possible d’attendre que les autorités compétentes à l’égard de ce médecin aient pris une décision le concernant.
- Application à l’affaire soumise au Conseil d’Etat
Dans le dossier dont le Conseil d’Etat avait à connaître, 3 des 4 pouvoirs de suspension avaient été mis en œuvre. En effet, la PUPH avait été suspendue par :
- L'université,
- Le centre hospitalier,
- Les ministres.
Deux de ces trois décisions sont confirmées. En effet, le Conseil d’Etat considère, d’une part, que les nombreux témoignages quant au comportement de la PUPH en question rendaient ses fautes suffisamment graves et vraisemblables, d’autre part, que le service a été suffisamment perturbé par ces faits. Il considère donc que l’université puis les ministres pouvaient la suspendre de ses fonctions dans l’attente de l’issue de la procédure disciplinaire.
En revanche, la suspension décidée par le centre hospitalier (qui ne pouvait être prononcée qu’en cas de circonstances exceptionnelles tenant au danger pour la continuité du service et à la sécurité des patients) est annulée.
En effet, le Conseil d’Etat considère que le maintien de cette PUPH dans son service médical ne menaçait pas la sécurité des patients et la continuité du service.
Cela démontre donc que, pour ce type très particulier de suspension, les conditions d’application sont extrêmement strictes.
Le 15/05/2020
Par un arrêt n° 19NT01513 du 10 janvier 2020 la cour administrative d’appel de Nantes semble prendre le contrepied de la jurisprudence du Conseil d’Etat en matière d’infractions routières et de naturalisation.
En effet, au vu de la jurisprudence du Conseil d’Etat, l’on peut considérer que les infractions routières « anciennes », de plus de quatre ans à la date de la décision (voir sur ce point le commentaire de la décision CE. CHR. 30 janvier 2019, n° 417548, mentionnée aux tables), ne peuvent plus être opposées au demandeur à la naturalisation (CE. SSR. 28 avril 2014, n° 372679, publiée au Recueil).
Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt de la cour, était en cause un délit de conduite sans permis de conduire, intervenu 6 ans avant la date de la décision de refus de naturalisation.
Le tribunal administratif de Nantes avait annulé le refus de naturalisation au vu des standards rappelés ci-dessus en matière de délits routiers et de naturalisation.
La cour censure ce jugement en estimant que :
- L’infraction était d’une « gravité certaine »,
- L’infraction avait un caractère « encore récent ».
Elle semble donc faire preuve dans cette affaire de davantage de sévérité que le Conseil d’Etat qui a exposé sa position dans un certain nombre de décisions (CE. CHR. 30 janvier 2019, n° 417548, mentionnée aux tables ; CE. SSR. 28 avril 2014, n° 372679, publiée au Recueil).
Le 01/05/2020
Par une décision n° 428099 du 24 décembre 2019, le Conseil d’Etat estime que l’ex-doyen de l’université de Montpellier, qui avait été suspendu de ses fonctions à la suite des violences intervenues au sein de l’université au cours de la nuit des 22 et 23 mars 2018, pouvait voir cette suspension prolongée pendant près d’un an.
Dans cette affaire, sont en cause les événements qui se sont déroulés à l’université de Montpellier à l’occasion des mouvements contre la réforme des universités en mars 2018.
En effet, au cours de ces mouvements étudiants, l’université de Montpellier a été occupée par les étudiants et, dans la nuit du 22 et 23 mars 2018, ces derniers ont été attaqués par des personnes cagoulées armées de bâtons et de matraques.
Des soupçons avaient alors très vite été portés sur le doyen de la faculté de droit et sur différents enseignants, qui auraient facilité voire participé aux actions violentes contre les étudiants occupant l’université.
Ces soupçons avaient d’ailleurs été rapidement confirmés par l’administration à travers un rapport de l’inspection générale de l’éducation nationale.
Aussi, le doyen de l’université avait été suspendu de ses fonctions sur le fondement de l’article L. 951-4 du code de l’éducation qui permet de suspendre, pendant une durée maximale d’an, un enseignant.
Deux conditions cumulatives sont posées pour une telle suspension :
- Que les faits imputés à l’agent aient un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité (CE. SSR. 10 décembre 2014, n° 363202, mentionnée aux tables). Il s’agit d’une transposition de la condition posée par l’article 30 de la loi du 13 juillet 1983.
- Que la poursuite des activités de cet agent au sein de l’établissement présente des inconvénients « suffisamment sérieux » pour le service ou pour le déroulement des procédures en cours (CE. CHR. 30 mai 2018, n° 418844 ; CE. CHR. 18 juillet 2018, n° 418844, publiée au Recueil).
Au cas présent, était en cause non pas la suspension en elle-même mais le maintien de cette suspension.
En effet, une première suspension avait été prononcée le 28 mars 2018 (soit quelques jours après les faits) et avait été prolongée plusieurs fois et, une dernière fois le 20 décembre 2018 pour trois mois.
C’est cette ultime suspension que le doyen contestait devant le Conseil d’Etat.
Toutefois, ce dernier estime que les deux conditions mentionnées ci-dessus sont remplies :
- D’une part, les faits imputés au doyen sont suffisamment vraisemblables et graves. La Haute juridiction se fonde, pour ce faire, sur le rapport de l’inspection générale de l’administration de l’éducation nationale.
- D’autre part, l’émotion suscitée par ces événements était encore vive plusieurs mois après les faits de sorte que le « déroulement normal des activités d’enseignement au sein de l’université » rendait nécessaire le maintien de cette suspension.
Cette première décision du Conseil d’Etat dans cette affaire médiatique ne devrait pas être la dernière.
En effet, des sanctions, actuellement portées devant le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), ont été prononcée contre le doyen et certains professeurs. Nul doute qu’elles seront, in fine, soumises au Conseil d’Etat.
Droit de retrait des enseignants et coronavirs (Codiv-19)
Le 17/04/2020
Voici mon intervention dans le journal Marianne à propos de l'exercice du droit de retrait des enseignants au moment du déconfinement, en raison du Codiv-19 (coronavirus) : https://www.marianne.net/societe/reouverture-des-ecoles-pourquoi-il-sera-delicat-pour-les-enseignants-de-faire-valoir-leur
Le handicap n’est pas un motif valable de refus de naturalisation
Le 15/04/2020
Par une décision n° 421050 du 29 novembre 2019, le Conseil d’Etat estime qu’il n’est pas possible de fonder un refus de naturalisation sur une maladie, un handicap, ou sur l’insuffisance des ressources du demandeur, si cette insuffisance résulte de son handicap.
Cette affirmation de principe constitue une avancée mais montre, d’emblée, ses limites.
En effet, la question du handicap dans la naturalisation a fait l’objet de quelques décisions de principe par le passé.
● Ainsi, dans un premier temps, le Conseil d’Etat avait considéré qu’il était possible de tenir compte de l’état de santé du demandeur pour refuser sa naturalisation mais pas de se fonder exclusivement sur son handicap si ce dernier n’avait pas d’incidence sur son intégration notamment professionnelle (CE. SSR. 26 septembre 2001, Ministre de l’emploi c. Mme Farida X, n° 206486, mentionnée aux tables).
Autrement dit, à cette époque, il était possible de se fonder sur le handicap d’une personne pour refuser sa naturalisation si ce handicap l’empêchait de travailler et donc de « s’intégrer » professionnelle.
Cette position était donc assez discriminatoire mais constituait une petite avancée par rapport à l’état du droit antérieur qui permettait une totale discrimination.
● Dans un deuxième temps, le Conseil d’Etat a jugé que l’administration ne pouvait se fonder, pour rejeter une demande de naturalisation, exclusivement sur le handicap d’une personne ou sur la circonstance que cette dernière ne disposait pas de revenus propres et vivait uniquement des aides liées à son handicap (CE. SSR. 11 mai 2016, n° 389399, mentionnée aux tables).
● La décision commentée constitue le troisième temps du raisonnement.
En effet, dans cette décision, le Conseil d’Etat :
▪ D’une part, fait disparaître le terme « exclusivement » de sa jurisprudence antérieure. Plus précisément, il pouvait être déduit de la rédaction antérieure des décisions que si l’administration ne pouvait pas se fonder « exclusivement » sur le handicap d’une personne pour justifier un refus de naturalisation, cet élément pouvait néanmoins être utilisé pour justifier un refus.
Par la nouvelle rédaction retenue, la Haute juridiction lève tout doute sur le sens et la portée de la jurisprudence en indiquant désormais sans ambiguïté qu’il n’est pas possible de se fonder sur le handicap ou la maladie d’une personne pour refuser de la naturaliser, même de manière incidente.
▪ D’autre part, s’agissant des revenus, le Conseil d’Etat indique qu’il appartient à l’autorité étatique de s’interroger pour déterminer si la faiblesse des revenus du demandeur à la naturalisation est « directement » liée à son handicap.
Si la faiblesse des revenus est liée au handicap ou à la maladie du demandeur, il n’est pas possible de le lui opposer. En revanche, si le demandeur à la naturalisation ne parvient pas à démontrer que la faiblesse de ses revenus est liée à son état de santé, alors cela peut lui être opposé.
Cette seconde précision ouvre donc la voie à une analyse (nécessairement délicate) de la situation des requérants.
En effet, et autrement dit, il ne suffit pas que les demandeurs à la naturalisation soient atteints par un handicap pour que les conditions tenant aux revenus et à l’intégration professionnelle ne leur soient pas opposables. Et la perception d’allocations de compensation du handicap ne suffit pas à faire regarder les faibles revenus du demandeur comme étant « directement » liés à son handicap.
Le Conseil d’Etat ne donne pas de méthode pour apprécier ce lien entre faibles revenus et handicap mais les conclusions de Guillaume Odinet sur cette décision indiquent que « la perception d’allocations de compensation du handicap » sera « un élément probant particulier » sans créer de présomption automatique.
Il faudra donc que les juridictions examinent, en détail, chaque demande émanant de personnes en situation de handicap pour déterminer si la faiblesse de leurs revenus est « directement » liée à leur handicap.
L’appartenance à une association liée au FPLP justifie un refus de naturalisation
Le 01/04/2020
Par un arrêt n° 18NT04125 du 8 novembre 2019, la cour administrative d’appel de Nantes estime que l’appartenance à une association affiliée au FPLP, même si le postulant affirme qu’il a cessé d’appartenir à cette association, permet de refuser la naturalisation du demandeur pour « défaut de loyalisme » envers la France.
Dans cette affaire, était en cause un demandeur, membre actif de plusieurs associations palestiniennes pendant plusieurs années, qui s’était vu refuser sa naturalisation au motif tiré de son absence de loyalisme envers la France.
Plus précisément, le ministre s’était fondé sur les « renseignements défavorables » obtenus sur le demandeur pour refuser sa naturalisation.
En effet, il convient de rappeler qu’il est possible, selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, de se fonder sur des renseignements défavorables obtenus sur un demandeur pour refuser sa naturalisation (CE. SSR. 30 avril 1993, Ministre de la solidarité c. époux X, n° 116146), étant précisé que ces « renseignements », qui peuvent par exemple émaner de la police, n’ont pas à être démontrés par une quelconque condamnation.
Dès lors, leur champ d’application est particulièrement large et mal défini.
Dans l’affaire jugée par la cour administrative d’appel de Nantes, le demandeur à la naturalisation était accusé d’appartenir à différentes associations de jeunes palestiniens affiliées au Front populaire pour la libération de la Palestine (FPLP).
Ce dernier ne contestait pas y avoir appartenu mais contestait continuer à y appartenir.
Bien que les services de l’Etat ne démontrent pas la persistance de son appartenance à ces associations au-delà de 2014, la cour retient que cette appartenance est démontrée.
A cet égard, la décision est intéressante du point de vue de la charge de la preuve dans la mesure où la cour retient que « s'il soutient, en revanche, avoir cessé d'appartenir à cette association, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ».
Ce faisant, la cour inverse la charge de la preuve et considère que dès lors que l’Etat affirme que l’intéressé appartient toujours à ces associations, il incombe au requérant de démontrer qu’il n’y appartient plus. Cette position est pour le moins étonnante dans la mesure où l’Etat se fondant sur cet élément, contesté, pour justifier sa décision, il appartenait en principe à ce dernier de démontrer que ses allégations étaient fondées.
La cour relève ensuite que ces associations étaient affiliées au FPLP qui est inscrit sur la liste européenne des organisations terroristes.
Elle en déduit donc que le ministre n’a pas commis d’erreur de fait en retenant ces renseignements défavorables.
Le 25/03/2020
Par une décision n° 433296 du 15 janvier 2020, le Conseil d’Etat transmet une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité à la Constitution de la restriction du droit d’accès aux algorithmes de Parcoursup.
En effet, comme cela a pu être exposé précédemment (voir le commentaire de la décision UNEF c. université des Antilles mentionnée infra), l’article L. 612-3 du code de l’éducation restreint le droit d’accès aux « informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise » et exclut l’accès à leur code source.
Le Conseil d’Etat avait, quelques mois auparavant, jugé que ces dispositions s’appliquaient également aux syndicats étudiants et non uniquement aux étudiants eux-mêmes (CE. CHR. 12 juin 2019, UNEF c. université des Antilles, n° 427916, mentionnée aux tables).
Dans la décision commentée, il estime que ces dispositions posent une question de constitutionnalité qu’il transmet au Conseil constitutionnel.
Plus précisément, les requérants et leurs avocats soutenaient que ces dispositions méconnaissent l’article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen. En effet, cet article prévoit :
« La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration ».
Or, le Conseil constitutionnel a considéré que cet article garantissait un droit constitutionnel d’accès aux archives publiques (décision n° 2017-655 QPC du 15 septembre 2017).
Certes, il a d’emblée limité (de manière classique) ce droit en rappelant qu’il devait se concilier avec les autres exigences constitutionnelles et l’intérêt général. Mais il n’en demeure pas moins qu’il a donné une assise constitutionnelle au droit d’accès aux archives publiques.
Le droit d’accès aux documents administratifs étant d’une nature très proche du droit d’accès aux archives publiques, il apparaît logique de s’interroger sur le caractère constitutionnel de ce droit et sur la constitutionnalité de la restriction apportée par le législateur au droit d’accès des étudiants et des syndicats étudiants aux algorithmes de Parcoursup.
Reste maintenant à attendre la décision qui sera prise par le Conseil constitutionnel.
Le 17/02/2020
Par une décision n° 409659 du 24 juin 2019, le Conseil d’Etat considère que le service public de la restauration dans les collèges, transféré aux départements par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, est un service public facultatif. Autrement dit, les départements ne sont pas tenus de prendre en charge la restauration scolaire dans les collèges.
L’affaire ayant donné l’occasion au Conseil d’Etat de trancher cette question opposait une commune (la commune de Fondettes) et un département (le département d’Indre-et-Loire). La commune, l’Etat et le département avaient conclu une convention en 1985 au moment de l’ouverture du collège local, en vertu de laquelle la commune s’engageait à assurer les repas servis aux élèves du collège.
Cette convention a été modifiée par la suite mais le principe selon lequel la commune devait se charger de la fourniture des repas est resté le même.
C’est dans ce contexte que la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est venue modifier la répartition des compétences en matière de restauration scolaire dans les collèges.
En effet, antérieurement à cette réforme, la compétence en matière de restauration scolaire (cantines) appartenait à l’Etat dans les collèges. Toutefois, en pratique, et dans de nombreuses hypothèses, ce n’était pas l’Etat assurait ce service mais les collectivités locales.
Avec le transfert de cette compétence au département, la commune de Fondettes a estimé que ce dernier étant désormais responsable de la restauration dans les collèges (article L. 213-2 du code de l’éducation), il devait en assumer la charge financière.
Aussi, elle a lancé un recours contre ce dernier.
La cour administrative d’appel de Nantes a fait droit à cette demande en considérant que la restauration dans les collèges constituait une dépense obligatoire pour les départements.
Toutefois, le département d’Indre-et-Loire a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
La question qu’avait donc à trancher le Conseil d’Etat était donc la suivante : le service public de la restauration scolaire dans les collèges est-il un service public obligatoire ?
La réponse à cette question a deux conséquences : si un service public est obligatoire cela signifie, d’une part, que la collectivité est tenue de le mettre en place et, d’autre part, que si une autre collectivité le prend effectivement en charge, elle peut en demander le remboursement à la collectivité responsable.
S’agissant de la restauration scolaire (les cantines), le Conseil d’Etat avait déjà eu l’occasion de se prononcer avant comme après la réforme sur le caractère obligatoire ou non de ce service.
Il avait alors jugé, de manière générale, qu’il ne s’agissait pas d’un service public obligatoire, que ce soit dans les écoles maternelles ou primaires, les collèges ou les lycées (CE.SSR. 11 juin 2014, n° 359931, publiée au Recueil ; CE. Sect. 5 octobre 1984, n° 47875, publiée au Recueil).
La question paraissait donc tranchée.
Cependant, le libellé du nouvel article L. 213-2 du code de l’éducation permettait de douter du bien-fondé de cette solution générale, à propos des départements.
En effet, ledit article indique désormais : « Le département a la charge des collèges. Il en assure la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement. / Le département assure l'accueil, la restauration, l'hébergement ainsi que l'entretien général et technique, à l'exception des missions d'encadrement et de surveillance des élèves, dans les collèges dont il a la charge. […] ».
Cette référence directe à la restauration comme étant un service assuré par le département, au même titre que la construction ou l’entretien des collèges, l’on pouvait aisément estimer que le service public avait changé de nature pour devenir obligatoire pour les départements.
Cependant, le Conseil d’Etat considère, à la lumière des travaux parlementaires relatifs à cette loi, que la nature de ce service public n’a pas changé malgré le libellé du texte.
Aussi, il considère que le service de la restauration scolaire reste, avant comme après la réforme, un service facultatif.
Autrement dit, les départements ne sont aujourd’hui pas tenus de mettre en place des services de restauration scolaire dans les collèges et, si d’autres collectivités le font à sa place, elles ne peuvent lui demander de prendre leurs dépenses en charge.
Le 06/02/2020
Par un arrêt n° 19NT00757 du 19 juillet 2019, la cour administrative d’appel de Nantes s’est prononcée sur le cas d’un postulant qui avait sollicité sa naturalisation mais se l’était vu refuser au motif que certains de ses enfants étaient restés dans son pays d’origine, sans que ce dernier n’ait fait de demande de regroupement familial à leur égard.
Ce type d’hypothèse n’a, en soi, rien de très original dans la mesure où ce motif est très classiquement avancé par les services de l’Etat pour estimer que le « centre [des] intérêts » (CE. Sect. 28 février 1986, n° 57464, publiée au Recueil) du demandeur n’est pas situé en France et qu’il ne réside donc pas en France au sens du code civil.
En revanche, la réponse apportée par la cour à ce recours est différente de ce qu’elle est généralement.
En effet, dans ce type d’hypothèse où celui qui demande sa naturalisation a des enfants mineurs résidant en France et d’autres à l’étranger, le juge vérifie en général si les enfants restés au pays ont fait l’objet d’une demande de regroupement familial (voir, par exemple, en ce sens : CAA Nantes, 28 mai 2018, n° 17NT01947 ; CAA Nantes, 29 décembre 2017, n° 16NT02288 ; CAA Nantes, 16 septembre 2016, n° 15NT03356).
Si une demande de regroupement familial a été déposée avant la décision se prononçant sur la demande de naturalisation du postulant, le juge considère alors que le centre des intérêts du demandeur se trouve en France. Si aucune demande de regroupement familial n’a été déposée, le juge estime que le demandeur à la naturalisation n’a pas le centre de ses intérêts en France.
Le raisonnement derrière cette position du juge est le suivant : si le demandeur à la naturalisation considère réellement la France comme son pays, alors il a nécessairement sollicité le regroupement de sa famille sur le territoire ; s’il ne l’a pas fait, c’est que ses intérêts dans son pays d’origine sont trop forts pour qu’il soit regardé comme « résidant » en France.
Ce raisonnement, quelque peu simpliste, est critiquable et tend à gommer la réalité des choses qui fait que diverses raisons, dont certaines sont totalement extérieures au demandeur à la naturalisation, peuvent justifier que certains enfants du postulant restent dans leur pays d’origine (la première de ces raisons étant qu’ils peuvent, par exemple, être le fruit d’un premier lit et qu’il n’est pas possible d’imposer à l’autre parent leur venue en France).
Or, dans la décision commentée, la cour administrative d’appel de Nantes s’éloigne quelque peu de la position de principe présentée ci-dessus.
En effet, dans cette affaire, le demandeur à la naturalisation avait dix enfants. Huit de ces enfants étaient français et vivaient en France avec le postulant et leur mère (également française). Le postulant avait deux autres enfants, lesquels résidaient avec leur mère comorienne aux Comores.
Le tribunal saisi de cette affaire avait considéré que le demandeur à la naturalisation n’ayant jamais fait de demande de regroupement familial pour les deux enfants nés aux Comores d’une relation adultère, le centre de ses intérêts n’était pas situé en France.
Si la cour avait appliqué les principes évoqués ci-dessus, elle aurait confirmé la position adoptée par le tribunal selon laquelle en l’absence de demande de regroupement familial, la résidence de certains enfants à l’étranger s’opposait à la naturalisation.
Cependant, elle s’écarte de cette position. En effet, elle relève l’absence de demande de regroupement familial mais n’en tire aucune conséquence. Elle relève au contraire que le demandeur à la naturalisation :
- Séjourne de manière continue en France,
- Vit avec son épouse française et leurs huit enfants français,
- A des ressources d’origine française.
Elle en déduit donc que même si le demandeur à la naturalisation n’a pas rompu tout lien avec ses enfants vivant aux Comores et dispose toujours de l’autorité parentale sur eux, le centre de ses attaches familiales est situé en France.
Ainsi, la cour met en balance les différents éléments de la vie du demandeur à la naturalisation pour en déduire que le centre de ses attaches familiales est en France, au lieu de poser, comme auparavant, une condition tenant à l’existence d’une demande de regroupement familial.
Cette technique, qui relève davantage de celle du faisceau d’indices paraît plus adaptée à l’appréciation des situations concrètes des demandeurs à la naturalisation. L’on peut donc espérer qu’elle permettra plus de souplesse et conduira, à terme, à l’abandon du « critère » de la demande de regroupement familial qui, dans un certain nombre de cas, relève d’une approche artificiel des relations familiales.
Le 20/01/2020
Par une décision n° 427916 du 12 juin 2019, le Conseil d’Etat vient confirmer la restriction du droit d’accès des syndicats d’étudiants aux algorithmes de « Parcoursup » mis en place par l’Etat et les universités.
Dans cette affaire était en cause la demande de l’UNEF, adressée à l’université des Antilles, portant, d’une part, sur les procédés algorithmiques utilisés pour traiter les candidatures via la plateforme Parcoursup et, d’autre part, les codes sources correspondants.
L’université ayant refusé de lui communiquer les algorithmes demandés, l’UNEF s’est tournée vers le tribunal administratif la Guadeloupe, qui a fait droit à sa demande.
Toutefois, en cassation, le Conseil d’Etat estime que les syndicats étudiants n’ont aucun droit à la communication de ces algorithmes.
Cette solution mérite que l’on s’y attarde.
Pour parvenir à cette conclusion, le Conseil d’Etat fait application d’un principe classique, qui implique de rappeler les règles applicables en matière de communication de documents administratifs.
● En effet, dans cette matière, il est désormais acquis que tout administré peut obtenir la communication de tout document détenu par l’administration (à moins qu’il soit protégé par certains secrets).
Ce principe de transparence a été institué par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 afin de mettre un terme à l’opacité administrative en forçant cette dernière à communiquer les documents qu’elle émettait.
Avec l’informatisation accrue de la vie administrative, le traitement algorithmique des demandes des administrés a pris de l’essor.
Or, dans ce cadre, il a été considéré, sans aucune difficulté, que lesdits algorithmes et les codes sources qui y étaient attachés constituaient des documents administratifs communicables (voir, par exemple, les avis de la CADA n° 20144578 du 8 janvier 2015 et n° 20161990 du 23 juin 2016).
Cette question s’est posée avec une particulière acuité à propos d’APB (qui a donné lieu à l’avis n° 20161990 du 23 juin 2016).
Toutefois, en pratique, les administrations éducatives ont fait preuve d’un mauvais vouloir particulièrement évident dans la communication de ces algorithmes, de sorte que les associations d’étudiants qui ont demandés ces documents n’ont jamais réellement pu les exploiter.
C’est la raison pour laquelle, afin de faciliter l’accès des étudiants aux informations utiles quant au traitement algorithmique de leurs candidatures, il a été prévu, à l’occasion de la création de Parcoursup, une publicité spécifique de ces algorithmes.
Ces modalités spécifiques, prévues à l’article L. 612-3 du code de l’éducation, ont cependant eu pour effet de restreindre les documents que les étudiants étaient en mesure de demander en indiquant que la communication « des informations relatives aux critères et modalités d'examen de leurs candidatures ainsi que des motifs pédagogiques qui justifient la décision prise » était réputée suffisante pour satisfaire le droit d’accès des étudiants.
De la sorte, il faut en déduire que les étudiants ne sont plus en droit de solliciter les codes sources en eux-mêmes et doivent s’en remettre aux seules informations fournies par les universités.
● Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat vient encore restreindre le droit d’accès à ces algorithmes.
Pour cela, il fait application d’un principe classique en vertu duquel une règle spécifique prévaut sur une règle générale (specialia generalibus derogant).
Plus précisément, il a considéré que l’article L. 612-3 du code de l’éducation, qui organise le droit d’accès aux algorithmes pour les étudiants, était une règle spéciale qui venait se substituer aux règles générales relatives à la communication des documents administratifs.
Il en déduit que les règles générales ne trouvent plus à s’appliquer aux algorithmes de Parcoursup.
Or, l’article L. 612-3 du code de l’éducation ne prévoit rien pour la communication des algorithmes aux syndicats étudiants.
Le Conseil d’Etat a donc estimé que ces syndicats n’avaient pas droit à la communication desdits algorithmes.
Ainsi, du silence de cette règle spéciale à l’égard des associations d’étudiants, le Conseil d’Etat déduit que ces associations ont perdu leur droit à la communication de ces algorithmes (qui était auparavant reconnu sans difficulté).
Cette position vient donc grandement restreindre la possibilité d’action des syndicats étudiants qui, en pratique, ne pourront plus examiner ces algorithmes.
D’ailleurs, dans cette affaire, la Commission d’accès aux documents administratifs avait déploré cette restriction du droit d’accès aux algorithmes et invité les universités à les publier spontanément (avis n° 20184400 du 10 janvier 2019).
En effet, il apparaît difficilement acceptable au XXIème siècle que l’Etat puisse utiliser des algorithmes sans que quiconque n’ait, en pratique, la possibilité de contrôler la manière dont ces algorithmes sont utilisés.
Plus précisément, les étudiants n’ont aujourd’hui plus le droit d’accéder au code source et doivent s’en remettre aux informations qui leur sont données par les universités. De la sorte, ils n’ont aucune possibilité de contrôler l’application qui est faite de ces algorithmes et doivent croire sur parole les universités. Or, dans le même temps, les syndicats étudiants sont purement et simplement exclus du droit d’accès aux informations relatives.
Ainsi, plus personne n’est en mesure de contrôler les algorithmes Parcoursup.
Le 08/01/2020
Par une décision n° 410644 du 27 février 2019, le Conseil d’Etat estime qu’un étudiant peut être sanctionné pour des faits qui se sont déroulés en dehors de l’établissement avec un autre étudiant si ces faits ont été connus dans l’établissement et ont affecté son bon fonctionnement.
Dans cette affaire le Conseil d’Etat avait à connaître d’une décision rendue par le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) à propos d’un étudiant, exclu définitivement d’un IEP à la suite d’une procédure disciplinaire, pour avoir commis des violences volontaires « avec usage ou menace d’une arme » sur un autre étudiant mais en dehors de l’établissement.
L’élève sanctionné et son avocat soutenaient que ces faits, commis en dehors de l’université, ne relevaient pas de la compétence des instances universitaires car ils ressortaient de la sphère privée et relevaient donc uniquement des juridictions civiles et pénales.
La question qu’avait à trancher le Conseil d’Etat était donc assez classique pour lui, qui a régulièrement à déterminer, en matière de fonction publique, si faits relevant de la sphère privée peuvent ou non justifier une procédure disciplinaire et une sanction.
● En matière de fonction publique, sa position est relativement claire.
Tout d’abord, si les faits sont d’ordre purement privé et n’ont pas eu de retentissement au sein du service, alors il n’est pas possible de fonder une sanction sur ces faits (CE. SSR. 15 juin 2005, n° 261691, publiée au Recueil).
Ensuite, et revanche, si les faits (généralement pénalement répréhensibles) ont porté atteinte à la réputation ou l’image de l’administration, alors ils peuvent donner lieu à une procédure disciplinaire et justifier une sanction même si la faute n’a, en réalité, pas de lien avec le service (voir, par exemple : CE. SSR. 24 juin 1988, Secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications, n° 81244, publiée au Recueil).
Enfin, même si les faits n’ont connu aucune publicité et n’ont donc pas porté atteinte à la réputation de l’administration, ils peuvent donner lieu à une sanction si leur gravité les rend incompatibles avec les fonctions effectivement exercées par l’agent (CE. SSR. 27 juillet 2006, Agglomération de la région de Compiègne, n° 288911).
Pour les fonctionnaires la situation est donc assez balisée.
● Pour les étudiants, la jurisprudence était moins claire, jusqu’à l’intervention de la décision commentée.
En effet, les étudiants qui sont de simples usagers de l’université et n’ont pas vocation à la représenter, de sorte que la jurisprudence citée ci-dessus n’est pas transposable.
Il n’est, par exemple, pas ici possible de s’interroger sur la compatibilité d’une condamnation pénale avec les « fonctions » d’un étudiant au sein d’une université.
Toutefois, dans la décision commentée, le Conseil d’Etat prend une position qui consiste, peu ou prou, à une transposition de sa jurisprudence en matière de fonction publique.
Plus précisément, il retient que l’étudiant peut être sanctionné par l’université pour des faits qui se sont déroulés à l’extérieur si ces faits portent atteinte à l'ordre et au bon fonctionnement de l'établissement. En effet, les universités sont bien compétentes pour connaître de tels faits en vertu de l’article R. 712-10 du code de l’éducation.
Cette atteinte au bon fonctionnement de l’université se caractérise en l’espèce (à la lecture des abstrats de la décision) par, en premier lieu, l’atteinte au climat régnant dans l’établissement et, en second lieu, l’atteinte à la santé et la scolarité de la victime.
De la sorte, on retrouve le même raisonnement que celui prévalant pour les fonctionnaires : un événement, même privé, peut justifier une procédure disciplinaire et une sanction d’un étudiant si son comportement à l’extérieur rejaillit sur l’université.
C’est la raison pour laquelle le Conseil d’Etat confirme en l’espèce la décision du CNESER.
Quels sont les effets de la naturalisation pour les enfants nés d’une gestation pour autrui ?
Le 08/01/2020
Par une décision n° 411984 du 31 juillet 2019, le Conseil d’Etat aborde la délicate question des effets de la naturalisation de l’un des parents lorsque ce dernier a des enfants nés, à l’étranger, d’une gestation pour le compte d’autrui (ci-après GPA).
En effet, en principe, lorsqu’un postulant est naturalisé, ses enfants suivent le même chemin que lui, s’ils sont mineurs et s’ils résident avec lui. C’est ce que prévoit l’article 22-1 du code civil.
Ce principe est appliqué avec constance par les juridictions et n’appelle que peu de commentaires. Son fondement est logique, à savoir qu’il serait contraire à l’intérêt de l’enfant mineur de ne pas disposer de la même nationalité que ses parents.
En pratique, soit le décret de naturalisation mentionne initialement le nom des enfants et leur naturalisation, soit cette mention est ajoutée ultérieurement en cas d’oubli.
Dans l’espèce dont a eu à connaître le Conseil d’Etat dans la décision commentée, était en cause la naturalisation d’un ressortissant australien.
Ce dernier avait été naturalisé mais, ses deux enfants, nés d’une GPA au Colorado (où ce procédé est autorisé), n’avaient pas été mentionnés sur le décret de naturalisation. Quelques jours après la naturalisation, le ministre chargé des naturalisations a pris une décision indiquant expressément que cette naturalisation n’aurait aucun effet sur les deux enfants, ces derniers étant nés d’une GPA.
Pour justifier son raisonnement, le ministre se fondait sur l’article 16-7 du code civil qui déclare nulle toute convention ayant pour objet la gestation pour le compte d’autrui.
Le Conseil d’Etat avait donc à trancher l’articulation de ces différents textes avec, notamment, la Convention de sauvegarde des droits de l’Homme et la Convention des Nations-Unies sur les droits de l’enfant, qui consacrent toutes deux l’« intérêt supérieur de l’enfant ».
En effet, la Cour européenne des droits de l’Homme a par exemple considéré, dans un avis consultatif n° P16-2018-001 de Grande chambre rendu le 10 avril 2019 à la demande de la Cour de cassation française, que l’intérêt supérieur de l’enfant imposait que le lien de filiation entre la mère d’« intention » et l’enfant soit reconnu dans l’hypothèse où le lien de filiation avec le père biologique est établi et n’est pas contesté.
La Cour de cassation a d’ailleurs récemment tenu compte de cet avis en considérant que la transcription d’un acte d’état civil établi en Californie devait être, dans les circonstances de l’espèce, confirmée malgré l’existence d’une GPA (Cass. Plén. 4 octobre 2019, n° 10-19053, publiée au Bulletin).
La décision commentée apporte des éclairages sur la relation entre GPA et naturalisation à un double titre. En effet, le Conseil d’Etat tranche non seulement la question des effets de la naturalisation sur les enfants nés d’une GPA mais aborde également par un obiter dictum la question de la possibilité d’être naturalité pour une personne ayant eu recours, pour avoir des enfants, à la GPA.
● D’une part, le Conseil d’Etat relève que le recours à la GPA peut justifier le rejet d’une demande de naturalisation, en rappelant que la GPA est interdite en droit français.
Bien qu’il n’apporte de pas de précisions sur les motifs de cette position, cette décision paraît fondée sur la règle tiré de ce que le candidat à la naturalisation doit être de bonne vie et de bonnes mœurs (autrement dit, son comportement doit être conforme aux règles de droit et de moral nationales). Or, le recours à une GPA à l’étranger peut être soit regardé comme une fraude visant à contourner la loi française, soit comme un manquement à la morale publique (comme l’est, par exemple, la polygamie). C’est ce qui justifie, à n’en point douter, la décision du Conseil d’Etat.
Cette position confirme, au demeurant, celle adoptée par les juridictions du fond puisque la cour administrative d’appel de Nantes a déjà jugé que le recours à la GPA pouvait justifier un refus de naturalisation (CAA Nantes. CHR. 21 décembre 2017, n° 16NT01141).
● D’autre part, et en revanche, le Conseil d’Etat – abordant le fond du dossier – considère que si le ministre n’oppose pas au demandeur à la naturalisation la circonstance qu’il a recouru à une GPA, il ne peut pas utiliser cet argument pour refuser de naturaliser, en même temps, ses enfants.
En effet, le Conseil d’Etat estime qu’en l’espèce, dans la mesure où il n’est pas contesté que les actes d’état civil établis par l’Etat du Colorado sont authentiques, le droit au respect de la vie privée des enfants s’oppose à ce que la nationalité de leur père ne leur soit pas également reconnue.
Ainsi, le Conseil d’Etat s’inscrit dans le même courant que la Cour de cassation et la Cour européenne des droits de l’Homme et fait prévaloir l’intérêt supérieur de l’enfant sur les règles nationales.
Il va même plus loin que ces juridictions car, dans cette affaire, le lien biologique n’était établi qu’entre le postulant et l’un des deux enfants. Le second enfant étant l’enfant biologique de son époux.
Pourtant, le Conseil d’Etat fait bénéficier, sans distinction, les deux enfants de la nationalité française.
Cette question, pourtant tranchée par le Conseil d’Etat, ne ressort par des motifs de la décision mais des conclusions du rapporteur public Guillaume Odinet. En effet, le rapporteur public relève qu’en matière de transcription d’actes d’état civils étrangers, le juge civil n’accepte de transcrire l’acte que si le père était bien le père biologique.
Toutefois, il rappelle que n’est pas ici en cause la transcription d’actes d’état civil mais seulement la prise en compte de la filiation au stade de la naturalisation.
Il considère donc que la rigueur applicable en matière de transcription n’a pas à être transposée dans la mesure où les actes d’état civil établis par l’Etat du Colorado sont suffisamment probants. Mais surtout, il relève que l’intérêt supérieur de l’enfant s’oppose à une telle solution.
Il aurait, au demeurant, été quelque peu déconcertant de reconnaître l’effet collectif de la naturalisation pour seulement l’un des enfants du postulant au motif que le second est, biologiquement, l’enfant de son conjoint.
Ainsi, et in fine, le Conseil d’Etat estime que si l’Etat décide d’accorder à une personne sa naturalisation (ce qu’il est toujours en droit de refus puisqu’il n’existe aucun « droit » à la naturalisation : CE. SSR. 30 mars 1984, Ministre des affaires sociales, n° 40735, mentionné aux tables), alors il doit en faire également bénéficier ses enfants, même s’ils sont nés d’une GPA.
Le 30/11/2019
Par un arrêt n° 19NT00515 du 19 juillet 2019, la cour administrative d’appel de Nantes a considéré qu’il était possible de tenir compte du comportement d’un postulant, agent contractuel de l’armée, dans ses fonctions, qui dénotait un « un défaut de respect de la réglementation applicable » pour rejeter sa demande de naturalisation.
1. Dans cette affaire, était en cause la demande de naturalisation présentée par un ancien légionnaire. Cette demande avait été rejetée par le ministre de l’intérieur, motif pris des sanctions prononcées à son encontre à l’époque où le postulant était encore légionnaire (pour non-présentation, retard, non-respect des règles sanitaires, détention d’un ordinateur, etc.).
Malgré les appréciations élogieuses portées par les supérieurs hiérarchiques du postulant sur ses appréciations, le ministre avait considéré que ces sanctions justifiaient un rejet de sa demande de naturalisation.
Dans son arrêt, la cour commence par rappeler la formule qu’elle utilise classiquement selon laquelle « dans le cadre de cet examen d'opportunité, [le ministre] peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant » (CAA Nantes. CHR. 25 février 2014, n° 13NT02262). En effet, dans la mesure où la naturalisation n’est pas un « droit », c’est une décision prise en opportunité (CE. SSR. 30 mars 1984, Ministre des affaires sociales, n° 40735, mentionné aux tables), ce qui laisse une très large marge d’appréciation à l’administration.
Après cela, elle se penche sur les faits de l’espèce.
Elle constate alors que les faits en cause (sanctions par l’employeur public du demandeur) ne sont :
- Ni contraires à l’honneur,
- Ni contraires à la probité ou aux bonnes mœurs,
- Ni sanctionnées pénalement.
Cependant, elle ne censure pas la décision du ministre.
En effet, elle considère que ces sanctions récurrentes révèlent un « défaut de respect de la réglementation applicable » et qu’ainsi, malgré ses « appréciation élogieuses », le ministre pouvait légalement rejeter sa demande de naturalisation.
Une telle position stricte appelle plusieurs observations.
2. Cette solution rappelle que la naturalisation reste une mesure discrétionnaire pour l’Etat qui peut refuser de l’accorder à celui ou celle qui remplit les conditions pour l’obtenir, en se fondant sur de nombreuses informations recueillies sur les postulants.
D’ailleurs, l’utilisation dans le considérant de principe de cet arrêt de la formule « renseignements défavorables recueillis » montre le caractère particulièrement large de l’origine des renseignements que l’administration peut prendre en compte. En règle générale, l’administration se fonde sur les informations recueillies auprès de la justice, de la police, des services de renseignements et des services de l’Etat (notamment l’administration fiscale) pour apprécier le comportement d’une personne demandant sa naturalisation.
Au cas présent, la source de ces renseignements interroge quelque peu.
En effet, ces « renseignements défavorables » proviennent de l’employeur du postulant.
Certes, cet employeur n’est autre que l’Etat lui-même puisque l’intéressé était sous contrat avec la légion étrangère. Toutefois, il n’en reste pas moins que l’administration puis le juge ont retenu les sanctions infligées par un employeur à son agent pour refuser sa naturalisation.
3. Une telle position est problématique pour plusieurs raisons :
D’une part, elle ouvre une porte à la prise en compte, pour tous les postulants travaillant pour l’administration, des appréciations portées par leurs employeurs publics, de sorte que ces derniers puissent s’opposer à une naturalisation future.
En effet, dans cette affaire, était en cause un agent de la légion étrangère mais qu’aurait jugé la cour s’il s’était agi d’un agent de l’Etat travaillant dans un service administratif quelconque ou pour une collectivité territoriale ? Le juge aurait-il considéré que les appréciations et sanctions de la personne publique employeur avaient une telle importance ? de même qu’en aurait-il été si l’employeur n’avait pas été public mais privé ?
Il n’est pas possible de répondre avec certitude à ces questions.
En effet, c’est sans doute la position particulière des employés de la légion (qui sont à la fois sous contrat mais exercent des fonctions de défense de la nation) qui a poussé la cour à tenir compte de ces éléments.
Cependant, il n’est absolument pas certain que la cour n’en aurait pas tenu compte si l’employeur avait été un autre employeur public, voire privé. Dans la mesure où la cour n’a pas mentionné le caractère particulier de la position de légionnaire et s’est bornée à retenir que les sanctions dénotaient « un défaut de respect de la réglementation applicable », la portée de sa décision est difficile à apprécier.
Dès lors, par cet arrêt, la cour a ouvert une brèche et rendu plus poreuse la distinction entre comportement au travail et demande de naturalisation.
D’autre part, cette position apparaît particulièrement stricte dans la mesure où malgré les sanctions infligées à l’intéressé, ce dernier avait fait l’objet, dans son activité « d'appréciation élogieuses de ses supérieurs hiérarchiques ».
En effet, dès lors que les informations émanant de l’employeur public étaient prises en compte pour statuer sur sa naturalisation, il aurait paru opportun de se pencher sur l’appréciation générale du postulant par sa hiérarchie.
Toutefois, tel n’est pas le choix fait par la cour, qui reste très stricte et laisse une très large marge d’appréciation au ministre pour faire droit ou non à une demande de naturalisation.
Le 21/11/2019
Par un jugement du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de Montreuil rappelle qu’aucune sélection en master 2 n’est possible dès lors que la formation n’est pas sur la liste de celles où, par dérogation, une sélection était autorisée. Il précise que le fait que l’étudiant en question ait ou non été soumis à une sélection au moment de son entrée en master 1 ne change rien à ces principes.
1. En effet, le code de l’éducation prévoit (article L. 612-6 du code) que l’accès en master 1 peut être subordonné « au succès à un concours ou à l’examen du dossier du candidat ». A l’inverse, l’entrée en master 2 est en principe automatique pour les étudiants qui ont obtenu leur master 1 (article L. 612-6-1 du code de l’éducation).
Mais pour permettre la mise en place en douceur de cette réforme (puisqu’auparavant la sélection était effectuée – de manière illégale – entre le master 1 et le master 2), il a été prévu d’autoriser de manière dérogatoire certaines formations à effectuer une sélection entre le master 1 et le master 2 à condition qu’aucune sélection ne soit réalisée à l’entrée en master 1 (voir, sur ce point, l’article : L’entrée en master 1 peut désormais être, légalement, sélective).
Pour que cette sélection dérogatoire en master soit mise en œuvre, il est également nécessaire que la formation en cause soit mentionnée sur la liste dressée en annexe du décret n° 2016-672 du 25 mai 2016, qui est remise à jour tous les ans.
2. Dans l’affaire jugée par le tribunal administratif de Montreuil, la formation en cause figurait jusqu’à la rentrée universitaire 2019-2020 sur la liste des formations dans lesquelles une sélection pouvait être instaurée entre le master 1 et le master 2.
Toutefois, pour la rentrée universitaire 2019-2020, l’université avait maintenu la sélection à l’entrée en master 2, malgré la disparition de la formation en cause de la liste dérogatoire.
Devant le tribunal administratif de Montreuil, l’université tentais de justifier sa position en affirmant qu’il se dégageait des articles L. 612-6 et L. 612-6-1 du code de l’éducation un principe général selon lequel un étudiant qui n’avait pas été soumis une sélection en master 1 pouvait faire l’objet d’une sélection en master 2.
Par ce raisonnement, l’université cherchait donc à neutraliser la deuxième condition posée par ces articles pour qu’une sélection à l’entrée en master 2 soit légalement instaurée, à savoir que la formation en cause soit mentionnée sur la liste annexée au décret du 25 mai 2016.
Le tribunal a, assez logiquement, écarté cet argument.
D’une part, les textes sont particulièrement clairs. En effet, le principe est l’absence de sélection à l’entrée en master 2. La sélection n’est qu’une exception.
Or, il est prévu qu’un décret fixe la liste des formations qui peuvent bénéficier de cette dérogation.
Dès lors, si une formation n’est pas mentionnée sur cette liste, aucune circonstance ne peut justifier cette sélection au regard de l’article L. 612-6-1 du code de l’éducation.
D’autre part, il est clair qu’en l’absence de texte autorisant expressément la sélection, une telle sélection ne peut pas être mise en œuvre (CE. SSR. Avis, 10 février 2016, n° 394594, publié au Recueil).
Dans ces conditions, le tribunal juge, en substance, que la circonstance qu’un élève n’ait fait l’objet d’aucune sélection à son entrée en master 1 n’autorise pas, à elle seule, l’université à le soumettre à une sélection à l’entrée en master 2.
Le 19/11/2019
Par un arrêt n° 18NT04440 du 20 juin 2019, la cour administrative d’appel de Nantes estime que l’administration ne peut pas se fonder sur l’existence même de condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation pour rejeter une demande de naturalisation mais peut se fonder sur les faits à l’origine de ces condamnation pour estimer que le postulant n’est pas de « bonne vie et mœurs ».
Cette décision, contestable, se fonde sur une distinction artificielle (mais ancienne) entre condamnation et faits à l’origine de la condamnation pour neutraliser les effets de la réhabilitation.
1. En effet, il convient de rappeler qu’en vertu des articles 133-12 et suivants du code pénal, passé un certain délai, les peines infligées aux personnes condamnées sont regardées comme n’ayant jamais existé.
Ces dispositions ont vocation à préserver la paix sociale et instituent une forme de droit à l’oubli : passé un certain délai, si l’intéressé s’est bien comporté et ne s’est vu imposer aucune condamnation, il est considéré que son passé n’existe plus.
Aussi, l’article 133-11 du code pénal interdit formellement à l’administration « d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document quelconque ».
La Cour de cassation a eu l’occasion de juger que toute mention de condamnations ayant fait l’objet d’une réhabilitation devait conduire à la nullité de l’acte en faisant mention (Cass. Crim. 8 novembre 1995, n° 95-81306, publié au Bulletin). Elle a précisé qu’il en allait ainsi dans le domaine de l’acquisition de la nationalité (Cass. 1ère civ. 29 février 2012, n° 11-10970, publié au Bulletin).
Il est donc en principe formellement interdit de faire état d’une condamnation ayant donné lieu à réhabilitation à l’occasion d’une demande de naturalisation.
C’est ce qu’a confirmé, anciennement, le Conseil d’Etat (CE. SSR. 23 juin 1995, M. Mohammed X, n° 139897).
2. Dans l’arrêt commenté de la cour administrative d’appel de Nantes, rendu en matière de naturalisation, cette dernière neutraliser les effets de l’article 133-11 du code pénal.
En effet, après avoir censuré la décision de rejet de la demande de naturalisation, en tant qu’elle se fondait sur des condamnations réhabilitées par l’écoulement du temps, la cour considère que l’administration pouvait se fonder, non pas sur les condamnations en elle-même mais sur les faits condamnés pour estimer que le postulant n’était pas « de bonnes vie et mœurs » au sens de l’article 21-23 du code civil.
Autrement dit, la cour estime que même si les condamnations ont disparu et qu’il est interdit d’en faire mention, les faits condamnés restent et peuvent servir de base à un refus de naturalisation.
Cette solution apparaît critiquable dans la mesure où elle crée une distinction artificielle entre la condamnation et les faits condamnés qui n’est pas dans l’esprit des articles 133-11 et suivants du code pénal.
Comme indiqué ci-dessus, l’idée qui irrigue ces dispositions est que la personne condamnée, qui s’est bien conduite pendant un temps défini par la loi, doit être regardé comme étant à nouveau vierge de toute condamnation.
Le but de ces dispositions n’est pas d’interdire de se fonder sur les condamnations anciennes tout en autorisant à se fonder sur les faits à l’origine de cette condamnation. D’ailleurs, c’est pour cette raison que la loi interdit d’en faire mention « sous quelque forme que ce soit ».
Or, lorsque la cour administrative d’appel de Nantes retient : « Le requérant ne peut sérieusement soutenir que les faits de vol, vol avec violence, vol en réunion, violences volontaires et escroquerie ne porteraient pas atteinte à l'ordre public et aux bonnes mœurs. En dépit de leur relative ancienneté, ces agissements, dont la matérialité n'est pas contestée, sont de nature, eu égard à leur gravité et à leur caractère répété, à faire regarder le requérant comme n'étant pas, à la date de la décision contestée, de bonnes vie et mœurs », il ne peut être sérieusement contesté qu’elle fait mention de manière expresse d’infractions pénales qui ont été réhabilitées. En effet, la précaution tirée de l’utilisation des termes « faits » de vol, etc. et non pas de « condamnation pour » vol, etc. ne change rien à l’objet de ce rappel.
De la sorte, la distinction opérée par la cour est artificielle.
Cette position de la cour administrative d’appel de Nantes est ancienne (CAA Nantes, 30 juin 2006, n° 05NT01701) et rappelée régulièrement par cette dernière.
Elle n’en apparaît pas moins contraire à la lettre et à l’esprit de l’article 133-11 du code pénal.
De plus, cette position est difficilement compatible avec la jurisprudence de la Cour de cassation, qui est sévère en ce domaine (Cass. Crim. 10 novembre 2009, n° 09-82368, publié au Bulletin).
Ainsi, cette distinction artificielle retenue par la cour administrative d’appel est particulièrement critiquable.
Le 30/06/2019
Par une décision n° 417548 du 30 janvier 2019, le Conseil d'Etat revient sur la notion d'indignité justifiant l'opposition par le gouvernement à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger d'un Français.
Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 21-2 du code civil, l'étranger marié depuis plus de quatre ans avec un conjoint de nationalité française peut acquérir la nationalité française.
Toutefois, le gouvernement peut s'opposer à cette acquisition pour des motifs tirés de « l'indignité » et du « défaut d'assimilation » de l'intéressé. Cette opposition peut intervenir dans les deux ans suivant la déclaration de nationalité souscrite par l'intéressé. Le gouvernement doit cependant informer au préalable l'intéressé des motifs de son intention de s'opposer à cette acquisition afin de préserver le principe du contradictoire.
Dans l'affaire soumise au Conseil d'Etat, le gouvernement s'est opposé à l'acquisition de la nationalité de l'intéressé au motif qu'il avait été condamné à plusieurs reprises dans un passé récent par les juridictions pénales pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et avait fuit à l'occasion d'un accident de la circulation. En effet, la commission d'infractions peut constituer une indignité.
Le Conseil d'Etat insiste ainsi (comme le montrent d'ailleurs l'analyse et les abstrats de la décision) sur le caractère « encore récent » de ces évènements.
En effet, si les faits reprochés à l'intéressé sont « ancien[s] », le gouvernement ne peut pas nécessairement s'opposer à l'acquisition de la nationalité par l'intéressé (en fonction de leur gravité). Ainsi, dans une affaire où étaient en cause deux condamnations pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique datant de 4 ans à la date de la décision d'opposition du Premier ministre, le Conseil d'Etat avait censuré la décision du ministre (CE. SSR. 28 avril 2014, n° 372679, publiée au Recueil) pour ce motif.
Cela démontre donc que non seulement la gravité des infractions doit être prise en compte mais que leur ancienneté joue un rôle majeur pour le Conseil d'Etat. C'est ce qui ressort d'ailleurs de décisions plus anciennes (CE. SSR. 30 janvier 1991, Ministre de la solidarité c. M. Abdoulaye X, n° 99983, mentionnée aux tables) que la présente décision ne fait que rappeler.