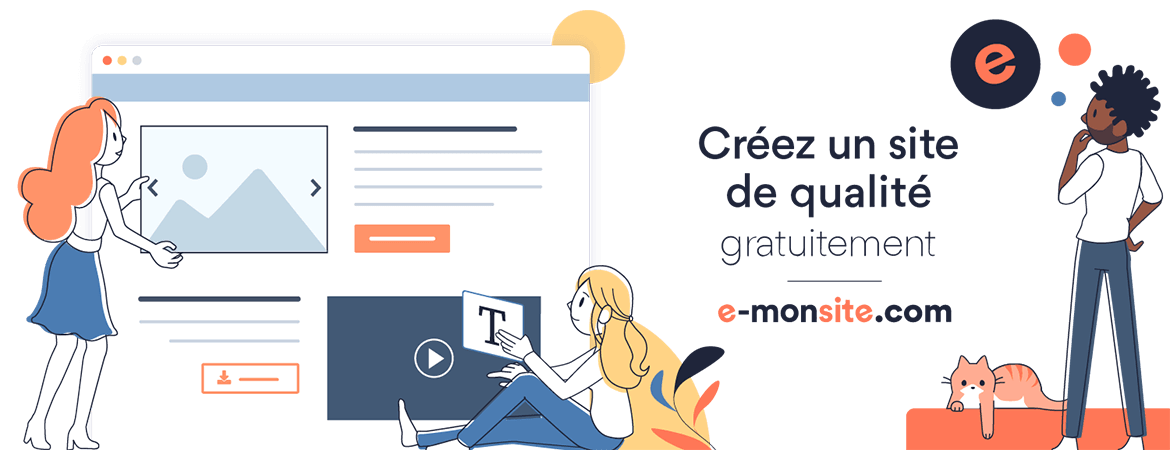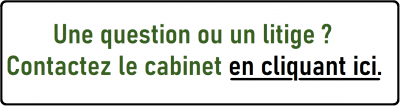- Accueil
- Blog
Blog
Le 20/04/2019
Par une décision n° 412317 du 30 novembre 2018, le Conseil d'Etat décline la compétence de la juridiction administrative pour les litiges opposant les maîtres de l'enseignement privé à l'Etat, même quand est en cause la légalité d'un acte administratif. Il se fonde sur les dispositions du code du travail calédonien pour considérer que les litiges des maîtres de l'enseignement privé relèvent de la compétence du tribunal du travail de Nouvelle-Calédonie.
En effet, il convient de rappeler qu'en Nouvelle-Calédonie, les agents contractuels de l'Etat relèvent des juridictions judiciaires pour les litiges qui les opposent à leur employeur public du fait du libellé des articles LP. 111-1, LP. 111-2 et LP. 111-3 du code du travail néo-calédonien (voir sur ce point l'article :Quelles spécificités pour les recours formés par les agents publics calédoniens ?).
Or, en l'espèce, les juridictions administratives s'étaient déclarées compétentes pour statuer sur un litige opposant un maître de l'enseignement privé au vice-recteur à propos d'une autorisation d'absence accordée puis finalement retirée et d'une retenue sur le traitement de l'agent.
Appliquant les articles en question du code du travail néo-calédonien et la jurisprudence du Tribunal des conflits en la matière (TC, 12 avril 2010, Mlle Nathalie A, n° C3747, publié au Recueil), le Conseil d'Etat juge les juridictions administratives incompétentes pour connaître de ce litige.
Ainsi, pour les maîtres de l'enseignement privé comme pour tous les agents contractuels de l'Etat et des collectivités territoriales en Nouvelle-Calédonie, la situation est simple : tous les litiges relèvent du juge judiciaire. C'est d'ailleurs ce qu'avait jugé quelques mois plus tôt le Tribunal des conflits (TC, 14 mai 2018, n° C4121).
La solution est donc plus simple que pour les agents contractuels métropolitains et surtout pour les maîtres de l'enseignement privé.
En effet, ces derniers sont liés par contrat avec l'Etat et la compétence en cas de litige a évolué au cours du temps en métropole.
Initialement, les juridictions administratives et judiciaires se disputaient la compétence pour ces agents, les secondes ayant reconnu, en sus du contrat liant ces agents à l'Etat, un contrat avec l'établissement. De la sorte, les litiges avec le rectorat relevaient des juridictions administratives et les litiges avec l'établissement relevaient des juridictions judiciaires (CE. SSR. 14 mars 1997, Mme Ruiz, n°158094, publiée au Recueil).
Toutefois, avec la modification de l'article L. 442-5 du code de l'éducation par la loi n°2005-5 du 5 janvier 2005, la situation s'est compliquée, la qualité d'agent public des maîtres de l'enseignement privé étant réaffirmée par le texte.
Désormais, les litiges les opposant aux établissements privés dans lesquels ils travaillent et qui touchent aux « conditions dans lesquelles leur contrat d'agent public est interprété et exécuté » relèvent des juridictions administratives même lorsque la décision émane du chef d'établissement (CE. CHR. 30 décembre 2013, n° 347047, mentionnée aux tables). Cette catégorie est assez floue mais il apparaît en tout cas que les litiges relatifs, par exemple, à l'emploi du temps de l'enseignant relèvent du juge judiciaire (même décision).
Ainsi, la situation des maîtres de l'enseignement privée est plus simple en Nouvelle-Calédonie qu'en métropole puisque tous leurs litiges relèvent du juge judiciaire.
Le 10/04/2019
Par une décision n° 411991 du 26 novembre 2018, le Conseil d'Etat rappelle les conséquences qu'il convient de tirer de la réception par l'administration d'une déclaration d'achèvement des travaux non-contestée à l'occasion de l'instruction d'un permis de construire postérieur.
En effet, il est acquis qu'à la fin des travaux autorisés par un permis de construire ou une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux, le demandeur doit adresser à l'administration une déclaration d'achèvement des travaux (article L. 462-1 du code de l'urbanisme).
A compter de la réception de cette déclaration, l'administration a trois (ou cinq) mois pour constater que les travaux ne sont pas conformes au permis de construire ou à la décision de non-opposition à déclaration préalable (articles L. 462-2 et R. 462-6 du code de l'urbanisme).
Cette formalité est souvent peu appréciée par les pétitionnaires, qui y voient un risque de contrôle et donc de retard dans la réalisation de leur opération.
Néanmoins, comme cela ressort de la décision commentée, c'est également une protection du constructeur.
Dans cette affaire, le Conseil d'Etat était amené à se prononcer sur les liens entre la déclaration d'achèvement des travaux, qui n'avait donné lieu à aucune réaction de l'administration et l'obligation de cette dernière, à l'occasion d'une nouvelle demande de permis de construire, de demander la régularisation des constructions et travaux irréguliers.
En effet, lorsqu'un pétitionnaire dépose une demande de permis de construire ou une déclaration préalable de travaux qui porte sur une construction existante (pour la modifier, l'étendre, etc.) l'administration doit lui demander, si cette construction existante n'est pas conforme au permis de construire initial (ou n'a fait l'objet d'aucune autorisation) de faire porter la nouvelle demande sur la régularisation de l'ensemble des travaux (voir, par exemple, en ce sens : CE. SSR. 16 mars 2015, n° 369553, publiée au Recueil).
En l'espèce, la cour administrative d'appel avait jugé, sur le fondement de cette obligation, que la nouvelle autorisation de modification de la construction existante était illégale puisque l'administration n'avait pas imposé au pétitionnaire de faire porter sa demande de permis de construire sur les travaux antérieurs qui n'étaient pas conformes au permis de construire.
Le Conseil d'Etat censure ce raisonnement en estimant que l'administration ayant reçu la déclaration d'achèvement des travaux et cette déclaration n'ayant suscité aucune réaction de sa part dans le délai imposé par les textes, la nouvelle demande de permis de construire n'avait pas à intégrer les travaux réalisés avant cette déclaration d'achèvement qui n'étaient pas conformes au premier permis de construire.
Autrement dit, si l'administration ne conteste pas la conformité des travaux à l'occasion de la déclaration d'achèvement des travaux, elle ne peut plus le faire ultérieurement.
Cette solution est donc protectrice des pétitionnaires.
Le Conseil d'Etat réserve toutefois assez classiquement l'hypothèse de la fraude.
Dans ce cas, il est classique et logique que cette déclaration d'achèvement ne produise pas ses effets, le silence de l'administration étant en réalité dû à la fraude du pétitionnaire (qui a par exemple caché les non-conformités lors d'un contrôle).
En dehors de cette hypothèse spécifique, la décision commentée donne donc tout intérêt au pétitionnaire de déposer une déclaration d'achèvement des travaux, cette dernière venant le protéger pour les éventuelles non-conformités de ses travaux au permis de construire qu'il avait initialement obtenu.
L'interêt à agir contre un permis de construire doit être bien justifié par l'avocat
Le 03/04/2019
Par une décision n° 422460 du 18 mars 2019, le Conseil d'Etat vient faire application des règles (désormais plus restrictives) en matière d'intérêt à agir contre un permis de construire en estimant qu'un voisin, qui était séparé du terrain d'assiette du projet par une parcelle boisée de 67 mètres de large, et dont l'habitation était éloignée de 200 mètres de la future construction, n'avait pas intérêt à agir contre le permis de construire délivré au demandeur.
En effet, pour pouvoir contester un permis de construire, il est nécessaire d'avoir un « intérêt à agir » contre cette décision administrative. C'est-à-dire d'être lésé ou susceptible d'être lésé de manière plus ou moins directe par cette décision.
1. De manière générale en contentieux administratif, le Conseil d'Etat entend assez largement l'intérêt à agir afin de faire respecter la légalité. Il n'est donc pas extrêmement exigent quant aux intérêts que les requérants mettent en avant pour justifier la recevabilité de leur recours.
En revanche, en matière de contentieux de l'urbanisme et notamment de permis de construire, la haute juridiction a toujours eu une appréciation un plus restrictive de cet intérêt. Ainsi, traditionnellement, le Conseil d'Etat et les juridictions administratives se fondaient sur trois éléments (voir, par exemple, en ce sens : CE. SSR. 27 octobre 2006, n° 286569, mentionnée aux tables) pour apprécier l'existence ou non d'un intérêt à agir :
- la distance entre le projet et l'habitation du requérant,
- la nature et l'importance du projet,
- la configuration des lieux.
Bien que plus restrictifs que les critères habituels prévalant pour le recours contre les autres décisions administratives, ces critères restaient relativement larges et permettaient assez facilement aux personnes du voisinage, sauf configuration très particulière, de contester un permis de construire.
Toutefois, avec la réforme du 18 juillet 2013 (ordonnance n° 2013-638), la notion d'intérêt à agir a été définie avec davantage de rigueur.
En vertu de ces dispositions nouvelles, l'intérêt à agir contre un permis de construire n'est désormais reconnu que si le projet est de « nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu[e le requérant] détient ou occupe ». L'objectif de cette réforme était, de manière claire, de limiter les recours formés par les voisins et leurs avocats contre les projets d'urbanisme.
Au vu de la rédaction retenue, il était difficile en 2013 d'apprécier si les exigences des juridictions seraient drastiques ou non.
En effet, il aurait été envisageable que cette affectation directe des conditions d'occupation se résume, par exemple, à une perte d'ensoleillement ou une gêne directe et démontrée (bruit, vue, etc.). Auquel cas seuls les voisins directs (et encore) auraient été regardés comme disposant éventuellement d'un tel intérêt.
Cependant, par deux décisions (CE. SSR. 10 juin 2015, n° 386121, publiée au Recueil ; CE. SSR. 13 avril 2016, n° 389798, publiée au Recueil), le Conseil d'Etat est venu préciser la portée qu'il fallait donner à ces dispositions.
Il a ainsi défini la méthode qui doit être suivie pour apprécier l'existence ou non d'un intérêt à agir :
- Tout d'abord, le requérant ou son avocat, doit avancer les éléments précis qui démontrent selon lui que les conditions d'occupation ou de jouissance du bien qu'il occupe sont affectées (nuisances principalement),
- Ensuite, le défendeur ou son avocat doit au contraire apporter tous les éléments démontrant le contraire,
- Enfin, en conclusion – et c'est là que l'apport du Conseil d'Etat est le plus important – le juge doit écarter les arguments insuffisamment étayés mais ne doit pas exiger « la preuve du caractère certain des atteintes » invoquées par le requérant ou son avocat.
Autrement dit, si le requérant et son avocat soutiennent que des nuisances vont être subies, elles doivent seulement être crédibles, il n'est pas nécessaires qu'elles soient démontrées.
C'est la raison pour laquelle dans la décision du 10 juin 2015, le Conseil d’Etat a jugé que le recours contre le permis de construire autorisant une station de conversion électrique à 700 mètres du domicile des requérants était recevable même si les requérants et leurs avocats ne démontraient pas la nuisance sonore émanant de cette station.
En effet, il n'était pas contesté qu'une station existante, située à 1,6 km, causait des nuisances sonores pour les requérants.
L'entreprise défenderesse faisait valoir que la nouvelle station utiliserait des technologies différentes et empêcherait ainsi les nuisances. Toutefois, le Conseil d'Etat constate que cette société n'apporte par la preuve de cette absence de nuisances concernant la future station et se contente de l'affirmer. C'est pourquoi il conclut à la recevabilité du recours.
Ainsi, cela montre que contrairement à ce que l'on pouvait penser initialement, toute la charge de la preuve de l'intérêt à agir ne pèse pas sur le requérant et sur son avocat mais se trouve partagée entre les parties.
De plus, par la décision du 13 avril 2016, il a créé une présomption d'intérêt à agir du voisin direct s'il fait état de la nature, de l'importance et de la localisation du projet. Autrement dit, il ne dispense pas le requérant et son avocat de se prévaloir de nuisances mais facilite leur preuve.
Dès lors, et dans tous les cas désormais, il appartient aux avocats de prendre bien soin, dans chaque recours contre un permis de construire – et dès le stade de la requête – de se prévaloir des nuisances subies par les requérants.
2. C'est donc au vu de ce contexte juridique qu'a été rendue la décision du 18 mars 2019 ici commentée dans laquelle le Conseil d'Etat vient faire application des principes exposés dans ses précédentes décisions.
Dans cette affaire, était en cause la construction d'une habitation dans une zone relativement inhabitée et principalement boisée. Le permis de construire avait été attaqué par un voisin dont la propriété était séparée du terrain d'assiette de la nouvelle construction par une parcelle de 67 mètres de large, apparemment boisée. La construction nouvelle devait se trouver à 200 mètres environs de la construction existante.
Pour justifier son intérêt à agir, le requérant et son avocat se prévalaient de ce que les boisements présents ne suffisaient pas à « occulter toute vue et tout bruit ». Le juge du référé avait considéré que cet argument était suffisant pour que le recours soit jugé recevable.
Toutefois, le Conseil d'Etat considère que ces éléments n'étaient pas suffisants. En effet, il estime qu'il n'est pas possible de se fonder sur la seule circonstance que les boisements séparant le terrain d'assiette n'occulteraient pas « toute vue et tout bruit » pour juger le recours recevable. Il annule donc l'ordonnance rendue par le juge des référés.
Cette décision permet donc, une nouvelle fois, au Conseil d'Etat de préciser sa jurisprudence en la matière au vu des principes qu'il a antérieurement posés.
D'une part, l'on en déduit qu'un voisin, dont la propriété est séparée par une parcelle (même non construite) du terrain d'assiette du projet n'est pas un voisin direct. En effet, le Conseil d'Etat ne fait pas mention dans sa décision de la présomption qu'il avait posée au bénéfice des voisins directs.
Cette solution paraît logique dans la mesure où même s'il n'y a aucune habitation entre les deux terrains d'assiette, le voisinage n'est matériellement pas direct.
Toutefois, il faut conserver à l'esprit que cette solution a été rendue au vu de la situation géographique de cette affaire. En effet, dans une hypothèse plus délicate où les deux terrains seraient séparés par une parcelle de petite taille, il n'est pas certain que le Conseil d'Etat n'aurait pas fait jouer la présomption. Si les deux terrains n'avaient été séparés que par une parcelle de quelques mètres, il n'aurait sans doute pas vu cette parcelle comme un obstacle au jeu de la présomption. Mais dans la présente espèce où les deux terrains étaient séparés par une parcelle de 67 mètres de long, la logique voulait que la présomption ne joue pas. Et ce, d'autant que la construction autorisée par le permis de construire devait être érigée à 200 mètres de la construction existante.
D'autre part, cette décision montre que si le Conseil d'Etat n'exige pas la « preuve du caractère certain des atteintes » invoquées par le requérant et son avocat pour justifier l'intérêt à agir, il demeure néanmoins nécessaire que ces atteintes présentent une certaine crédibilité.
En effet, le simple fait qu'il n'existe pas un bois d'une importance suffisante permettant d'occulter toute vue et tout bruit ne suffit pas à caractériser l'affectation des conditions d'occupation, d'utilisation et de jouissance du bien.
Cette solution apparaît, ici encore, logique au vu des exigences des nouveaux textes. Sauf à vider de leur substance les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, il n'est pas possible de considérer que la construction d’une habitation située à 200 mètres et séparée par des terrains boisés constitue une « atteinte » aux conditions de jouissance du bien si le requérant et son avocat ne se prévalent pas d'arguments précis.
En effet, il convient de conserver à l’esprit que la solution retenue par le Conseil d’Etat n'est pas une position de principe. Il prend bien soin de préciser que ces éléments ne suffisent pas « à eux seuls » à caractériser une atteinte directe aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien.
Autrement dit, si le requérant et son avocat s'étaient prévalus de cette circonstance et d'autres arguments (par exemple une augmentation du trafic routier, une vue directe sur leur jardin, etc.), le recours aurait pu être jugé recevable. Mais, le seul élément – relativement abstrait – tiré de ce que les arbres n'occulteraient pas toute vue et tout bruit n'est pas suffisant.
3. En conclusion, à la lecture de cette décision et des précédentes, il est certain que les requérants et leurs avocats doivent être particulièrement attentifs aux arguments avancés pour justifier l'intérêt à agir contre un permis de construire.
En effet, il ne suffit pas d'avancer des arguments abstraits tels que l'existence d'une vue, ou la possibilité éventuelle d'entendre le bruit. Il est nécessaire d'avancer des arguments crédibles et étayés par la situation très concrète des lieux.
De plus, et par sécurité, cette démonstration devrait désormais être réalisée a priori dès le dépôt de la requête par l'avocat, sans attendre que le mémoire en défense soulève cette irrecevabilité. En effet, si cette démonstration n'est pas réalisée et étayée d'emblée, il existe un risque non négligeable que le juge se saisisse immédiatement du moyen. Pour éviter cet écueil et limiter au maximum le débat sur cette question, il est donc préférable de justifier dès l'origine la recevabilité du recours.
Le 30/03/2019
Par une décision n° 409872 du 9 novembre 2018, le Conseil d'Etat vient appliquer la jurisprudence M. Czabaj (CE. Ass. 13 juillet 2016, n° 387763, publiée au Recueil) au contentieux du permis de construire et limite, en principe, à un an le recours contre les permis de construire qui ont été affichés sans mentionner le délai de recours.
1. En effet, s'agissant des autorisations d'urbanisme (permis de construire, non-opposition à déclaration préalable, etc.), les délais de recours ne commencent pas à courir à compter de la publication de la décision par l'autorité publique.
Le délai de recours commence à courir pour les tiers à compter de l'affichage du permis de construire sur le terrain (article R. 600-2 du code de l'urbanisme). Cet affichage, pour faire courir le délai de recours, doit comporter un certain nombre de mentions prévues aux articles R. 424-15 et A. 424-15 et suivants du code de l'urbanisme (l'absence de certaines mentions est cependant sans incidence sur le départ du délai de recours).
Toutefois, le code de l'urbanisme prévoit lui-même une limite en l'absence d'affichage du permis de construire (ou en cas d'affichage défectueux). En effet, il n'est plus possible, même en l'absence d'affichage, de contester un permis de construire au terme d'un délai de six mois à compter de l'achèvement des travaux (article R. 600-3 du code de l'urbanisme).
L'idée derrière ces dispositions est que les tiers ont parfaitement eu le temps, en constatant la réalisation des travaux, de s'interroger sur la consistance du projet et d'aller consulter le permis de construire en mairie. S'ils n'ont pas cru bon de contester le permis de construire pendant la construction et dans un délai de six mois après l'achèvement des travaux, alors leur inertie s'oppose à ce qu'ils puissent contester indéfiniment le projet.
2. En matière de contentieux administratif général, les règles de base sont différentes. Le principe qui prévalait jusqu'ici était que la notification d'une décision ne faisait pas courir les délais de recours si cette notification ne comportait pas les voies et délais de recours (R. 421-5 du code de justice administrative). Or, ce principe a connu il y a quelques années une atténuation jurisprudentielle importante.
Avant cela, et par application stricte de ces dispositions, le Conseil d'Etat considérait que si la notification d'une décision ne comportait pas les voies et délais de recours, la décision pouvait être contestée indéfiniment par celui qui l'avait reçue.
Néanmoins, par la jurisprudence M. Czabaj, le juge de cassation a mis un terme à cette interprétation littérale du texte en estimant que même en l'absence de notification comportant les voies et délais de recours, l'intéressé devait contester dans un délai raisonnable la décision en cause s'il l'avait bien reçue. Ce délai raisonnable était fixé à un an, sauf circonstances particulières.
3. Par la décision commentée, le Conseil d'Etat vient appliquer ce principe général au contentieux de l'urbanisme dans lequel il existait déjà une limite temporelle textuelle en l'absence d'affichage du permis de construire.
Transposant son raisonnement, il considère que si un permis de construire (ou une autre autorisation d'urbanisme) a été affiché et si cet affichage comporte les mentions exigées par l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme mais n'indique pas le délai de recours, alors le permis de construire ne pourra plus être contesté au-delà d'un délai raisonnable d'en principe un an.
Ainsi, il limite la portée de la décision de principe M. Czabaj en contentieux de l'urbanisme pour tenir compte de sa spécificité.
Autrement dit, il y aura désormais 4 cas à distinguer :
- Le permis de construire a été affiché et comporte les toutes les mentions exigées par l'article R. 424-15 et les articles A. 424-15 et suivants du code : le délai de recours de deux mois commence à courir à compter de l'affichage.
- Le permis de construire n'a pas été affiché : il peut être contesté jusqu'au terme d'un délai de six mois à compter de l'achèvement des travaux.
- Le permis de construire a été affiché mais cet affichage ne contient pas certaines des mentions exigées par l'article R. 424-15 et les articles A. 424-15 ou A. 424-16 du code : la question de l'opposabilité n'est pas réglée par la décision commentée. Il faut donc considérer que la jurisprudence antérieure continue à s'appliquer, c'est-à-dire qu'il faudra apprécier la nature des omissions pour déterminer si elles permettent de regarder le délai de deux mois comme opposable ou non. S'il n'est pas opposable, le permis de construire peut être contesté jusqu'au terme du délai de six mois à compter de l'achèvement des travaux.
- Le permis de construire a été affiché et contient toutes les informations exigées par les articles R. 424-15, A. 424-15 et A. 424-16 du code mais pas celles relatives au délai de recours de deux mois (article A. 424-17 du code) : il peut être contesté à l'expiration du premier de ces deux délais :
- 1 an à compter du début de l'affichage,
- 6 mois à compter de l'achèvement des travaux.
Ainsi, loin de simplifier les choses, l'application partielle de la jurisprudence M. Czabaj vient complexifier la détermination du délai de recours applicable.
Voir, sur la question du caractère définitif du permis de construire l'article : A quelle date un permis de construire est-il définitif ?
Le 20/03/2019
Par une décision n° 412542 du 25 octobre 2018, le Conseil d'Etat a indiqué que le juge administratif n'avait pas à contrôler le contenu des études exigées par les plans de prévention des risques à l'occasion des demandes de permis de construire, mais devait se borner à vérifier la présence au dossier de l'attestation de l'architecte indiquant que ces études existaient bien.
Il est nécessaire de rappeler d'emblée que l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme prévoit que le dossier de demande de permis de construire doit comporter une attestation de l'architecte confirmant la réalisation des études exigées par les plans de prévention des risques (naturels, miniers ou technologiques).
En effet, les plans de préventions des risques prévoient, dans certaines zones qu'il déterminent, l'obligation pour un constructeur d'effectuer une étude assurant la prise en compte des exigences de ce plan à l'occasion des demandes de permis de construire. L'article R. 431-16 du code de l'urbanisme indique que, dans cette hypothèse, le dossier doit comporter une attestation de l'architecte ou d'un expert, certifiant que cette étude a été réalisée et que le projet en tient compte.
Cette obligation apparaît logique dans la mesure où elle vise à assurer la prise en compte et l'effectivité de ces plans de prévention des risques.
C'est la raison pour laquelle le tribunal administratif de Montreuil avait considéré, à la demande du requérant, qu'il lui incombait également de vérifier le contenu de cette étude et en avait déduit que la seule attestation produite n'assurait pas la prise en compte de cette étude par le projet dès sa conception.
Dans la décision commentée, le Conseil d'Etat censure ce raisonnement en estimant que le juge doit se borner à vérifier l'existence de l'attestation au dossier.
Cette solution est conforme à la lettre du texte de l'article R. 431-16 du code de l’urbanisme qui exige seulement la présence au dossier de l'attestation.
Il convient néanmoins d'en tempérer la portée puisqu'une lecture rapide peut laisser penser que cette décision fait obstacle au contrôle par le juge administratif du respect des plans de prévention des risques lors de l'instruction des permis de construire. Or, une telle lecture est erronée.
En effet, les dispositions des plans de prévention des risques doivent être respectées par les dossiers de permis de construire. Comme l'a déjà jugé le Conseil d'Etat, les plans de prévention des risques sont des servitudes d'urbanisme qui s'imposent directement aux permis de construire. De la sorte, il appartient à l'administration de les appliquer et de refuser, le cas échéant, un permis de construire qui y serait contraire (CE SSR. 4 mai 2011, Commune de Fondettes, n° 321357, mentionnée aux tables).
Ainsi, les plans de prévention des risques doivent bien être respectés.
La décision commentée porte en réalité sur des zones assez précises où les plans de prévention des risques ne prévoient pas d'interdiction ou de restriction à la construction mais imposent la réalisation d'études.
Autrement dit, au vu des décisions précités :
- Le maire doit contrôler le respect des dispositions des plans de prévention des risques lors de l'instruction des permis de construire (interdictions, conditions, etc.),
- Mais le maire n'a pas à contrôler le contenu des études que peuvent exiger par les plans de prévention des risques, mais seulement se borner à vérifier que l'attestation exigée par l'article R. 431-16 du code de l'urbanisme est au dossier. Tel est donc l'apport de la décision commentée.
Précisions sur le délai de recours du préfet (déféré) contre un permis de construire tacite
Le 10/03/2019
Par une décision n° 400779 du 22 octobre 2018, le Conseil d'Etat est venu préciser les délais dans lesquels le préfet peut contester un permis de construire tacite lorsqu'il n'a reçu qu'un dossier incomplet.
Le Conseil d'Etat avait déjà eu l'occasion de régler la question du départ du délai de recours dont dispose le préfet à l'égard des permis de construire explicites et tacites. En effet, le permis de construire fait partie des actes que les collectivités territoriales ont l'obligation de transmettre au préfet pour qu'il exerce son contrôle de légalité. S'il estime le permis illégal, il peut le déférer au juge administratif dans un délai de deux mois.
Se pose donc nécessairement la question de savoir quand ce délai de deux mois commence à courir.
Lorsque le permis de construire est explicite, la réponse est assez simple. Le délai commence à courir à compter de la transmission de la décision de permis de construire est transmise au préfet. Concernant les permis tacites (qui naissent du silence de l'administration), la question est nécessairement plus compliquée.
Il a déjà été jugé que la transmission de l'entier dossier de demande (qui est en principe obligatoire) valait information du préfet, de sorte que le délai de recours de ce dernier commençait à courir à compter de la date à laquelle le permis de construire tacite était acquis (CE. SSR. 17 décembre 2014, n° 373681, mentionnée aux tables).
Dans la décision qui nous intéresse, le Conseil d'Etat vient préciser ce principe en indiquant, assez logiquement, que si le dossier de demande de permis de construire transmis au préfet est incomplet, alors le délai de recours ne commence pas à courir pour ce dernier.
Dès lors, si la commune demande au pétitionnaire des pièces complémentaires au cours de l'instruction du permis de construire (et même si elle n'en informe par le préfet en parallèle), le dossier qu'elle a transmis est regardé comme incomplet et le délai de recours du préfet ne commence pas à courir, sauf à ce qu'elle transmette les pièces complémentaires au préfet.
Voir, sur la question du caractère définitif du permis de construire l'article : A quelle date un permis de construire est-il définitif ?
Le 28/02/2019
Par une décision n° 412104 du 12 octobre 2018 le Conseil d'Etat rappelle qu'il n'est pas possible, après annulation d'un refus de permis de construire de manière définitive, de refuser ce permis pour l'un des motifs censurés par le juge, sauf évolution ultérieure des circonstances de fait.
En effet, dans l'affaire étudiée par le Conseil d'Etat, la société requérante avait sollicité, en 2007, l'octroi d'un permis de construire un parc éolien. Elle s'était vu opposer un refus par le préfet au motif que, par son impact visuel, le parc éolien portait atteinte à l'intérêt d'un château classé monument historique situé dans son champ de visibilité.
Toutefois, les juridictions administratives avaient annulé ce refus en estimant que l'impact visuel sur le monument historique était faible et n'y portait donc pas atteinte.
Exécutant cette décision, le préfet avait donc accordé ce permis de construire en 2011.
Un nouveau recours avait été formé contre ce permis de construire et le tribunal administratif, puis la cour, avaient annulé ledit permis en estimant cette fois que des éléments nouveaux faisaient apparaître une forte covisibilité entre le projet et un autre monument historique, et que de nouveaux photomontages montraient la forte prégnance visuelle du projet sur un site classé également proche.
Dans la décision commentée, le Conseil d'Etat censure ce raisonnement par application du principe de l'autorité de la chose jugée.
En effet, l'autorité de la chose jugée s'attache à l'ensemble des décisions de justice devenues définitives. Elle concerne non seulement le dispositif (le sens de la décision : annulation ou rejet) mais également les motifs de cette décision (les raisons pour lesquels le juge est parvenu à cette conclusion : CE. Sect. 28 novembre 1949, Société des automobiles Berliet, publiée au Recueil p. 579).
Au cas présent, les juges avaient finalement retenu le même motif que celui qu'ils avaient censuré quelques années auparavant par une décision devenue définitive (le jugement annulant le refus initial de permis de construire n'ayant pas été contesté).
Le Conseil d'Etat censure, assez logiquement ce raisonnement.
Même si les raisons retenues pour censurer le permis de construire délivré étaient quelques peu différentes de celles qui avait été initialement avancées pour refuser le permis de construire quelques années plus tôt, elles relevaient du même motif : l'impact visuel du projet.
Or, le Conseil d'Etat estime que « sans relever aucun changement qui aurait affecté la réalité de la situation de fait », la cour ne pouvait pas annuler le permis de construire pour ce motif, l'autorité de la chose y faisant obstacle.
Autrement dit, les juges auraient pu censurer le permis de construire du fait de son impact visuel (malgré le jugement contraire antérieur) si l'environnement avait évolué. Par exemple si un obstacle à la covisibilité entre deux bâtiments avaient disparu. En effet, si un immeuble qui était placé entre un monument historique et le parc éolien avait disparu, rendant celui-ci visible depuis un monument historique, alors la situation de fait aurait été nouvelle. Assez logiquement, le juge aurait alors été libre d'apprécier l'impact de cet élément nouveau sur la légalité du nouveau permis qui lui était soumis.
Cependant, en l'espèce, la situation de fait était restée la même. Seule l'argumentation avait été différente et apparemment fondée sur des photomontages plus parlants. Ces faits n'étant pas nouveau, le Conseil d'Etat considère que l'autorité de la chose jugée s'oppose à une annulation du permis de construire délivré.
Ainsi, à situation de droit et de fait constante, il n'est pas possible d'utiliser un motif qui a été censuré par le juge. Cette solution classique est à rapprocher de celle adoptée s'agissant des injonctions que le juge administratif peut prononcer en cas d'annulation d'un permis de construire (CE. CHR. Avis. 25 mai 2018, Préfet des Yvelines, n° 417350, publié au Recueil).
Le 20/02/2019
Par une décision n° 406222 du 3 octobre 2018, le Conseil d'Etat est venu préciser les conséquences qu'il convenait de donner à un arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) jugeant qu'un ressortissant étranger courrait, en cas de retour dans son pays d'origine, un risque réel d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants.
● En effet, il convient de conserver à l'esprit que la CEDH n'est pas une juridiction d'appel ou de cassation placée au sommet de l'ordre juridique interne. Aussi, ses décisions ne font pas disparaître les jugements ou arrêts rendus par les juridictions internes qui lui seraient contraires.
C'est là une grande différence avec les juridictions de cassation internes (Cour de Cassation et Conseil d'Etat) qui font disparaître les arrêts et jugements rendus antérieurement s'ils les annulent.
La CEDH n'a pas de pouvoir d'annulation des jugements et arrêts internes.
En revanche, les arrêts de la Cour ont un caractère obligatoire pour les Etats, qui doivent les exécuter en vertu de l'article 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Se pose donc régulièrement la question de la manière dont il convient de tenir compte de ces arrêts lorsque des décisions définitives contraires ont été rendues par les juridictions internes et ne peuvent donc plus être rapportées au moment où intervient l'arrêt de la Cour.
● En l'espèce, l'intéressé, qui s'était vu opposer un refus à la demande d'asile qu'il avait formée par l'OFPRA, avait contesté ce refus devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), sans succès.
A la suite de ces échecs et de l'obligation qui lui avait été imposée de quitter le territoire français, il avait saisi la CEDH en persistant à affirmer qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il était exposé à des traitements inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de la Convention. La Cour lui avait donné raison par un arrêt devenu définitif.
Fort de cet arrêt positif, il avait demandé le réexamen de sa demande d'asile à l'OFPRA, mais cette demande avait été rejetée et la CNDA saisie par lui avait confirmé ce refus en estimant que les risques dont il se prévalait n'étaient pas établis.
Le requérant s'est alors pourvu devant le Conseil d'Etat.
Ce dernier considère, dans la décision commentée, que la CNDA a commis une erreur de droit.
En effet, il rappelle qu'il appartient aux Etats parties à la Convention d'exécuter les arrêts de la Cour. Or, il juge que la complète exécution de l'arrêt de la CEDH impliquait en l'espèce que les autorités françaises octroient la protection subsidiaire au demandeur.
Le Conseil d'Etat indique néanmoins une limite, à savoir qu'il appartient à l'OFPRA et à la CNDA de vérifier que l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne trouve pas à s'appliquer (CESEDA).
Cet article permet en effet de s'opposer à l'octroi de la protection subsidiaire dans différentes hypothèses (lorsque la personne a commis un crime grave ou un crime contre la paix, la guerre ou l'humanité, ou d'autres circonstances du même ordre listées par cet article).
En l'espèce, le Conseil d'Etat relève que la CNDA ne pouvait refuser la protection subsidiaire que si l'article L. 712-2 du CESEDA s'y opposait. N'ayant pas relevé que ledit article s'opposait à l'octroi de la protection subsidiaire à l'intéressé, la CNDA a commis une erreur de droit.
● Ainsi, pour donner un plein effet à l'arrêt de la CEDH, l'OFPRA et la CNDA ne peuvent plus considérer que l'individu n'établit pas être soumis à un risque réel de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et doivent donc accorder la protection subsidiaire à celui qui la demande.
Ils peuvent seulement s'opposer à l'octroi de cette protection si un des motifs énumérés à l'article L. 712-2 du CESEDA s'y oppose.
Dès lors, par cet arrêt, le Conseil d'Etat donne une force qui s'approche de l'autorité de la chose jugée aux arrêts rendus par la CEDH.
Cette solution est d'ailleurs à comparer avec celle que la haute juridiction avait adoptée il y a quelques années à propos d'une décision de la CEDH demandant au gouvernement français de ne pas renvoyer un requérant dans son pays d'origine le temps qu'elle traite son recours (CE. CHR. 9 novembre 2016, n° 392593, mentionnée aux tables).
En effet, le Conseil d'Etat avait jugé que cette décision de la Cour s'opposait seulement au renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine mais n'obligeait pas la CNDA à surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la CEDH.
Cette différence d'autorité accordée à ces deux décisions de la Cour s'explique dans la mesure où dans l'affaire de 2014, la CEDH ne s'était pas prononcée sur le recours du requérant mais avait simplement demandé aux autorités françaises de ne pas le renvoyer dans son pays d'origine dans l'attente de son arrêt. Il était donc logique que cette décision, qui ne se prononçait pas sur le litige de l'intéressé ne fasse pas obstacle à la poursuite de la procédure devant la CNDA et, éventuellement, au rejet de sa demande.
La seule obligation de la France était alors d'attendre l'arrêt de la Cour qui devait se prononcer sur le recours de l'intéressé.
Dans l'affaire ici commentée, la décision de la CEDH en cause est à un stade ultérieur puisqu'il s'agit de son arrêt définitif se prononçant sur le risque encouru par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine. Elle n'a donc pas le même objet que dans l'affaire de 2014.
C'est ce qui explique la différence d'autorité accordée à ces deux décisions.