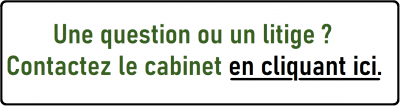- Accueil
- Blog
Blog
Le 20/02/2019
Par une décision n° 406222 du 3 octobre 2018, le Conseil d'Etat est venu préciser les conséquences qu'il convenait de donner à un arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) jugeant qu'un ressortissant étranger courrait, en cas de retour dans son pays d'origine, un risque réel d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants.
● En effet, il convient de conserver à l'esprit que la CEDH n'est pas une juridiction d'appel ou de cassation placée au sommet de l'ordre juridique interne. Aussi, ses décisions ne font pas disparaître les jugements ou arrêts rendus par les juridictions internes qui lui seraient contraires.
C'est là une grande différence avec les juridictions de cassation internes (Cour de Cassation et Conseil d'Etat) qui font disparaître les arrêts et jugements rendus antérieurement s'ils les annulent.
La CEDH n'a pas de pouvoir d'annulation des jugements et arrêts internes.
En revanche, les arrêts de la Cour ont un caractère obligatoire pour les Etats, qui doivent les exécuter en vertu de l'article 46 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Se pose donc régulièrement la question de la manière dont il convient de tenir compte de ces arrêts lorsque des décisions définitives contraires ont été rendues par les juridictions internes et ne peuvent donc plus être rapportées au moment où intervient l'arrêt de la Cour.
● En l'espèce, l'intéressé, qui s'était vu opposer un refus à la demande d'asile qu'il avait formée par l'OFPRA, avait contesté ce refus devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA), sans succès.
A la suite de ces échecs et de l'obligation qui lui avait été imposée de quitter le territoire français, il avait saisi la CEDH en persistant à affirmer qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il était exposé à des traitements inhumains et dégradants prohibés par l'article 3 de la Convention. La Cour lui avait donné raison par un arrêt devenu définitif.
Fort de cet arrêt positif, il avait demandé le réexamen de sa demande d'asile à l'OFPRA, mais cette demande avait été rejetée et la CNDA saisie par lui avait confirmé ce refus en estimant que les risques dont il se prévalait n'étaient pas établis.
Le requérant s'est alors pourvu devant le Conseil d'Etat.
Ce dernier considère, dans la décision commentée, que la CNDA a commis une erreur de droit.
En effet, il rappelle qu'il appartient aux Etats parties à la Convention d'exécuter les arrêts de la Cour. Or, il juge que la complète exécution de l'arrêt de la CEDH impliquait en l'espèce que les autorités françaises octroient la protection subsidiaire au demandeur.
Le Conseil d'Etat indique néanmoins une limite, à savoir qu'il appartient à l'OFPRA et à la CNDA de vérifier que l'article L. 712-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne trouve pas à s'appliquer (CESEDA).
Cet article permet en effet de s'opposer à l'octroi de la protection subsidiaire dans différentes hypothèses (lorsque la personne a commis un crime grave ou un crime contre la paix, la guerre ou l'humanité, ou d'autres circonstances du même ordre listées par cet article).
En l'espèce, le Conseil d'Etat relève que la CNDA ne pouvait refuser la protection subsidiaire que si l'article L. 712-2 du CESEDA s'y opposait. N'ayant pas relevé que ledit article s'opposait à l'octroi de la protection subsidiaire à l'intéressé, la CNDA a commis une erreur de droit.
● Ainsi, pour donner un plein effet à l'arrêt de la CEDH, l'OFPRA et la CNDA ne peuvent plus considérer que l'individu n'établit pas être soumis à un risque réel de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine et doivent donc accorder la protection subsidiaire à celui qui la demande.
Ils peuvent seulement s'opposer à l'octroi de cette protection si un des motifs énumérés à l'article L. 712-2 du CESEDA s'y oppose.
Dès lors, par cet arrêt, le Conseil d'Etat donne une force qui s'approche de l'autorité de la chose jugée aux arrêts rendus par la CEDH.
Cette solution est d'ailleurs à comparer avec celle que la haute juridiction avait adoptée il y a quelques années à propos d'une décision de la CEDH demandant au gouvernement français de ne pas renvoyer un requérant dans son pays d'origine le temps qu'elle traite son recours (CE. CHR. 9 novembre 2016, n° 392593, mentionnée aux tables).
En effet, le Conseil d'Etat avait jugé que cette décision de la Cour s'opposait seulement au renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine mais n'obligeait pas la CNDA à surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la CEDH.
Cette différence d'autorité accordée à ces deux décisions de la Cour s'explique dans la mesure où dans l'affaire de 2014, la CEDH ne s'était pas prononcée sur le recours du requérant mais avait simplement demandé aux autorités françaises de ne pas le renvoyer dans son pays d'origine dans l'attente de son arrêt. Il était donc logique que cette décision, qui ne se prononçait pas sur le litige de l'intéressé ne fasse pas obstacle à la poursuite de la procédure devant la CNDA et, éventuellement, au rejet de sa demande.
La seule obligation de la France était alors d'attendre l'arrêt de la Cour qui devait se prononcer sur le recours de l'intéressé.
Dans l'affaire ici commentée, la décision de la CEDH en cause est à un stade ultérieur puisqu'il s'agit de son arrêt définitif se prononçant sur le risque encouru par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine. Elle n'a donc pas le même objet que dans l'affaire de 2014.
C'est ce qui explique la différence d'autorité accordée à ces deux décisions.
Le 07/02/2019
Par une décision n° 412897 du 1er octobre 2018, le Conseil d'Etat rappelle qu'il peut être mis fin, pour l'avenir, à la protection fonctionnelle octroyée à un agent lorsqu'il apparaît que cette protection n'est pas plus due (ou ne l'a jamais été). Il précise qu'en matière de protection accordée en raison d'un harcèlement moral, l'intervention d'un jugement non-définitif des juridictions judiciaires ne retenant pas le harcèlement ne suffit pas à justifier qu'il soit mis fin à la protection. En revanche, les éléments révélés à cette occasion peuvent justifier l'arrêt de cette protection.
Il est désormais bien établi que la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 doit être octroyée à un agent public qui subi un harcèlement moral (voir sur ce point l'article : Harcèlement moral, protection fonctionnelle et droit de retrait).
Sur le fondement de ces dispositions, il arrive que la protection soit accordée à un agent qui s'estime harcelé. C'est ce qui s'était passé dans l'espèce jugée par le Conseil d'Etat.
Dans cette affaire, l'agent en question avait attaqué civilement et pénalement les auteurs présumés de ce harcèlement devant les juridictions judiciaires.
Or, ces dernières avaient considéré que le harcèlement n'était pas établi mais ce jugement avait été frappé d'appel.
Face à cette situation, l'administration avait considéré que la protection fonctionnelle n'était plus due. L'agent ayant contesté le terme mis pour l'avenir à sa protection fonctionnelle, la cour administrative d'appel saisie du litige avait considéré que, du fait du jugement rendu par les juridictions judiciaires, l'administration avait à bon droit mis un terme à la protection de son agent.
Saisi de ce litige, le Conseil d'Etat censure ce raisonnement en estimant : d'une part, que le jugement non-définitif rendu par les juridictions judiciaires ne pouvait justifier à lui seul la fin de la protection fonctionnelle et, d'autre part, qu'en revanche, les éléments nouveaux mis en lumière à l'occasion de cette procédure pouvaient justifier qu'il soit mis un terme à la protection.
Les précisions du Conseil d'Etat sur les possibilités de mettre un terme à la protection fonctionnelle d'un agent public octroyée en raison d'un harcèlement moral sont donc doubles.
En effet, il était d'ores et déjà établi que l'administration pouvait mettre un terme pour l'avenir à la protection fonctionnelle d'un agent lorsqu'il apparaissait qu'elle n'était plus justifiée ou ne l'avait jamais été (voir, sur ce point : CE. Sect. 14 mars 2008, M. André A, n° 283943, publiée au Recueil). En cela, la décision commentée n'apporte rien de nouveau, ce principe étant déjà établi. En revanche, elle apporte des précisions utiles en matière de protection fonctionnelle pour harcèlement.
● En premier lieu, le Conseil d'Etat indique que l'intervention d'une décision du juge judiciaire ne retenant pas la qualification de harcèlement moral ne justifie pas à elle seule le terme mis à la protection si cette décision du juge judiciaire n'est pas devenue définitive.
Cette solution apparaît logique dans la mesure où si le juge judiciaire est encore saisi en appel de la situation, alors elle n'est pas tranchée de manière définitive.
Cela signifie, a contrario, que si la décision du juge judiciaire qui ne retient pas la qualification de harcèlement moral est définitive, l'administration peut se borner à faire mention de cette décision pour justifier l'abrogation de la décision de protection.
● En second lieu, et dans la mesure où l'administration peut mettre un terme à la protection si elle n'apparaît pas ou plus justifiée, l'administration peut en revanche tenir compte des éléments qui auraient pu apparaître à l'occasion du procès devant le juge judiciaire.
En effet, si au cours des débats, des éléments dont elle n'avait pas connaissance apparaissent et lui permettent de considérer que sa protection n'était pas justifiée, alors elle peut les utiliser pour mettre un terme à sa protection. Mais elle doit alors justifier sa décision par ces éléments nouveaux et on par l'intervention du jugement en lui-même.
Le refus de naturalisation, le centre des intérêts et la résidence
Le 15/12/2018
Par une décision n° 416358 du 5 octobre 2018, le Conseil d’Etat rappelle que pour être naturalisé, un postulant doit avoir, en France, le « centre de ses intérêts ».
A la lecture des dispositions du code civil, une telle condition ne va pas de soi. En effet, le code civil se borne à exiger à son article 21-16, que le postulant réside en France à la date de sa naturalisation.
Toutefois, dans la pratique, l’administration et la jurisprudence sont allées plus loin en exigeant que le postulant ait le « centre de ses intérêts » en France (voir, par exemple, en ce sens : CE. Sect. 28 février 1986, n° 57464, publiée au Recueil) pour être naturalisé.
Dès lors, et en réalité, une condition supplémentaire à celle exigée par le texte (la résidence) a été ajoutée (le centre des intérêts).
Ainsi, à titre d’exemple, un étudiant, qui reçoit pour vivre de l’agent de l’étranger venant de sa famille n’est pas considéré comme ayant en France le centre de ses intérêts (CE. Sect. 28 février 1986, n° 50277, publiée au Recueil). De même pour un postulant dont les enfants mineurs vivent à l’étranger (CE. Sect. 26 février 1988, n° 70584, publiée au Recueil).
Les conditions pour que le « centre des intérêts » du postulant soit regardé comme étant situé en France sont donc assez strictes.
Dans la décision commentée, le Conseil d’Etat rappelle ces principes et la possibilité de tenir compte de la situation familiale du postulant pour apprécier où se trouve le « centre de ses intérêts ».
Appliquant ces principes à l’espèce, le Conseil d’Etat considère que la présence de l’épouse du postulant à l'étranger s’oppose à ce que le centre de ses intérêts soit regardé comme étant en France. Aussi, il confirme le refus de naturalisation.
A quel état d'un monument historique les travaux effectués sur celui-ci doivent-ils être conformes ?
Le 03/12/2018
Par une décision n° 410590 du 5 octobre 2018, le Conseil d’Etat vient apporter des précisions sur les travaux effectués sur les monuments historiques.
En effet, en vertu du code du patrimoine, il n’est pas possible de faire de quelconques travaux de restauration, modification ou démolition d’un immeuble classé monument historique sans autorisation de l’administration (article L. 621-9 du code). A cette occasion, l’administration vérifie (article R. 621-18 du même code) que les travaux :
Sont compatibles avec le statut d’immeuble classé,
- Ne portent pas atteinte à l’intérêt ayant justifié le classement,
- Ne compromettent pas la bonne conservation du bâtiment.
- Ces principes sont appliqués avec attention par l’administration.
A l’occasion de l’affaire jugée par le Conseil d’Etat dans la décision du 5 octobre 2018, ce dernier précise que pour analyser le projet de modification ou de restauration de l’immeuble classé monument historique, l’administration ne doit pas se référer à l’état ou à la configuration de cet immeuble à la date de son classement.
Elle doit prendre en compte l’intérêt qui a justifié la mesure de conservation.
Autrement dit, si, par exemple, le classement d’un immeuble a pour objet de préserver cet immeuble tel qu’il était lors de sa création et non lors de son classement, alors c’est à l’immeuble tel qu’il était lors de sa création qu’il faut se référer sans tenir compte des modifications postérieures.
Dans l’affaire jugée par le Conseil d’Etat, était en cause la modification de l’un des immeubles de la place Vendôme.
Or, le requérant (qui s’était vu opposer un refus au projet de modification qu’il avait préparé et avait formé un recours contre ce refus) reprochait à la cour administrative d’appel de Paris d’avoir apprécié son projet au regard de la configuration initiale de la place Vendôme lors de sa création et non au regard de la configuration de la place à la date de son classement.
Le Conseil d’Etat confirme cependant le raisonnement de la cour et apporte d’utiles précisions quant aux motifs de classement de la place Vendôme :
- Il relève d’une part que le classement avait pour objet de préserver l’ordonnancement initial de la place (et non son ordonnancement à la date du classement en 1862).
- D’autre part, il estime que cet ordonnancement initial de la place pouvait s’apprécier à la lumière des gravures de Jean-François Blondel lesquelles « donnaient, en l'état des connaissances, la description la plus précise, complète et certaine de la place Vendôme à la date de son achèvement ».
Il en déduit donc que le projet pouvait et devait être apprécié à la lumière de l’état initial de la place et non au vu de son état à la date de son classement.
Cet exemple montre donc l’importance des motifs retenus pour le classement d’un monument historique et impose donc de se pencher de manière assez précise sur ces motifs au moment d’éventuels travaux sur l’immeuble classé.
Déroulement des examens universitaire et juge du référé-liberté
Le 15/11/2018
Par une ordonnance n° 423727 du 20 septembre 2018 le juge des référés du Conseil d’Etat apporte d’intéressantes précisions quant à la qualification de « liberté fondamentale » au sens du référé-liberté à propos du droit à l’instruction et de ses corollaires pour les personnes atteintes d’un handicap.
En effet, dans cette affaire, une étudiante de master 2, atteinte d’un grave handicap et d’un cancer, avait saisi le juge du référé-liberté pour qu’il soit enjoint à son université : de limiter ses épreuves à 3 heures par jour et de l’autoriser à stocker un concentrateur d’oxygène dans les locaux de l’université.
Cette demande ayant été rejetée par le juge des référés du tribunal administratif de Paris, elle avait interjeté appel de cette ordonnance devant le juge des référés du Conseil d’Etat.
A l’occasion de cette affaire, le conseil d’Etat apporte des précisions quant à la possibilité, pour des étudiants, de se prévaloir de leur droit d’accès à l’instruction devant le juge du référé-liberté.
Néanmoins, avant d’exposer la position prise par le Conseil d’Etat, il est nécessaire de rappeler brièvement l’objet du référé-liberté.
1. La liberté fondamentale au sens du référé-liberté ne doit pas être confondue avec l’ensemble des principes ou objectifs de valeur constitutionnels protégés par la Constitution (malgré leur caractère fondamental).
En effet, un principe peut parfaitement être un principe constitutionnel fondamental sans pour autant pouvoir être mobilisé devant le juge du référé liberté. Il en va, par exemple, ainsi du principe d’égalité qui est l’un des principes sur lesquels est assise la Constitution alors que ce principe ne constitue pas une « liberté fondamentale » au sens du référé-liberté (CE. Ord. 1er septembre 2017, Commune de Dannemarie, n° 413607, mentionnée aux tables). De même pour le droit au logement, qui est pourtant un objectif de valeur constitutionnelle (CE. Ord. 3 mai 2002, Association de réinsertion sociale du Limousin et a., n° 245697, publiée au Recueil).
De même, tout droit conféré par la loi ou le règlement n’est pas un droit ou une liberté fondamentale dont on peut se prévaloir devant le juge du référé-liberté (voir, par exemple, le droit au congé-formation : CE. SSR. 28 mai 2001, M. Raut, n° 230888, mentionnée aux tables).
Ainsi, la liberté fondamentale au sens du référé-liberté est une catégorie à part qui permet seulement au juge de mettre en œuvre des pouvoirs particulièrement coercitifs à l’égard de l’administration. En effet, en référé-liberté, non-seulement le juge se prononce en 48h, mais il peut adresser des injonctions présentant un caractère définitif à l’administration.
Dès lors, ce n’est pas parce qu’un droit ou une liberté n’est pas qualifié de fondamental au sens du référé-liberté que ce droit ou cette liberté ne pourra pas conduire à l’annulation au fond d’une décision par le juge administratif. Cela signifie seulement qu’il ne sera pas possible de mettre en œuvre un référé-liberté.
Aussi, le Conseil d’Etat a une vision assez restrictive de ce qui relève de la liberté fondamentale, comme le montre le cas jugé en l’espèce.
2. En effet, dans l’ordonnance commentée, le juge des référés du Conseil d’Etat considère que les conditions de déroulement d’épreuves de master ne peuvent porter atteinte à aucune liberté fondamentale.
Bien que le juge ne précise pas, cela signifie que ces conditions ne portent pas atteinte au droit à l’instruction. C’est ce que soulevait la requérante, qui indiquait qu’était en cause l’égal accès à l’instruction.
Le Conseil d’Etat estime qu’il n’y a pas de liberté fondamentale en l’espèce, même dans l’hypothèse où sont en cause des conditions de déroulement des épreuves portant atteinte au principe d’égalité. Cette précision est logique au vu de la jurisprudence du Conseil d’Etat mentionnée ci-dessus qui considère que le principe d’égalité n’est pas une liberté fondamentale (CE. Ord. 1er septembre 2017, Commune de Dannemarie, n° 413607, mentionnée aux tables).
Concernant le droit d’accès à l’instruction en lui-même, le Conseil d’Etat ne précise pas pourquoi cette liberté fondamentale qu’il a reconnue par le passé (CE. Ord. 15 décembre 2010, Ministre de l’éducation nationale, n° 344729, publiée au Recueil) ne peut pas être mobilisée en l’espèce.
Il y a deux interprétations possibles de ce refus :
- D’une part, que la question des examens de master 2 n’est pas relative à l’« accès » à l’instruction mais à son déroulement, le Conseil d’Etat ayant simplement consacré comme liberté fondamentale la « privation » de « toute possibilité de bénéficier d’une scolarisation ». Autrement dit, la liberté fondamentale ne semble protéger que l’accès à l’instruction et non pas son déroulement.
- D’autre part, que le master, grade universitaire de haut niveau ne relève plus du droit à l’instruction, ce droit étant limité à la scolarisation (à l’apprentissage des fondamentaux). En effet, dans l’ordonnance du 15 décembre 2010 consacrant le droit à l’instruction, le Conseil d’Etat cite différents texte pour justifier l’existence de la liberté fondamentale, lesquels se rapportent à la scolarisation des enfants. De plus, par le passé, le Conseil d’Etat avait considéré que l’ « accès » à une formation de troisième cycle (un doctorat) ne relevait pas d’une liberté fondamentale (CE. Ord. 24 janvier 2001, Université Paris VIII-Vincennes Saint-Denis, n° 229501, publiée au Recueil).
Il est probable que ces deux éléments ont joué dans la position prise par le Conseil d’Etat, ce dernier considérant que n’était en cause, ni l’« accès » à une formation, ni le droit à l’instruction au sens stricte.
Cela signifie donc que les conditions de déroulement des examens de master (et sans doute de toute formation universitaire) ne peuvent faire l’objet d’un référé-liberté.
3. En revanche, le Conseil d’Etat ouvre une brèche pour les étudiants atteints d’un handicap ou d’un « trouble de santé invalidant ».
En effet, à l’égard de ces étudiants, un référé-liberté est envisageable s’il existe une « carence caractérisée » de l’administration dans la mise en œuvre des obligations d’aménagement qui pèsent sur elle. Pour apprécier l’existence de cette carence caractérisée, le Conseil d’Etat indique qu’il faut se référer :
- A l’état de santé de l’étudiant,
- Aux pouvoirs et moyens dont dispose d’administration.
L’on en déduit donc que plus la personne sera atteinte d’un handicap ou d’une pathologie grave, plus l’administration devra être diligente.
Mais l’on constate également que si l’administration a peu de moyens, cela pourra être opposé à l’étudiant puisque le constat de la carence dépend des moyens de l’établissement. Cette vision que l’on pourrait qualifier de réaliste, est toutefois problématique dans la mesure où les moyens des personnes publiques en charge de l’enseignement supérieur étant de plus en plus limités, cette carence dans le financement du service public de l’éducation pourra un jour servir à justifier le refus d’aménagement des conditions de passation d’une épreuve pas une personne handicapée.
Appliquant ces principes nouveaux à l’espèce, le juge des référés du Conseil d’Etat constate en l’espèce qu’en cours d’instance, l’administration s’est engagée à prendre un prestataire pour fournir des bouteilles d’oxygène à l’étudiante pendant ses épreuves et à fractionner l’épreuve de 7 heures mais pas celles de 4 heures 20. Il relève en outre que l’université devra faire preuve de « bienveillance » à propos de la question des horaires des examens.
Il en déduit qu’il n’y a pas de carence caractérisée de l’université à ses obligations de sorte que le référé est rejeté.
C’est donc à la lumière de ces précisions nouvelles que les étudiants handicapés pourront, en cas de besoin, tenter un référé-liberté dans la petite fenêtre ouverte par le Conseil d’Etat.
Le juge peut entendre toute "personne intéressée" pendant l'audience
Le 02/11/2018
Par une décision n° 408825 du 24 septembre 2018, le Conseil d’Etat vient préciser les conditions dans lesquelles une personne qui n’est pas partie à l’instance peut être autorisée à prendre la parole lors de l’audience.
En effet, il convient de conserver à l’esprit que la procédure devant les juridictions administratives est principalement écrite. C’est la raison pour laquelle les observations que peuvent faire les parties lors de l’audience ne leur permettent pas de soulever des moyens nouveaux et ne constituent pas, à proprement parler, des plaidoiries.
Le code de justice administrative prévoit en son article R. 732-1 que :
- Les parties peuvent présenter leurs observations,
- Le tribunal ou la cour peut entendre les agents de l’administration pour obtenir des explications,
- Le tribunal peut demander des éclaircissements à une personne présente dont l’une des parties souhaite l’audition.
Sur le fondement de ces dispositions (et du caractère écrit de la procédure devant les juridictions administratives) le Conseil d’Etat avait initialement une interprétation stricte de ces dispositions.
En effet, il estimait que le fait de donner la parole à une personne qui n’était pas partie à l’instance lors de l’audience entachait le jugement ou l’arrêt d’irrégularité. C’est ce qu’il avait jugé à propos de l’intervention d’un syndicat lors d’une audience à propos d’un recours formé par un autre syndicat contre la recevabilité d’une liste présentée à des élections professionnelles par un troisième syndicat (CE. SSR. 16 janvier 2002, SNPT, n° 196637, mentionnée aux tables), de même pour les observations présentées par l’époux de la requérante puisque celui-ci n’était pas lui-même requérant (CE. Sect. 6 octobre 1972, Ville de Bourges, n° 80837, publiée au Recueil).
Dès lors, le principe paraissait presque absolu.
Néanmoins, par la décision commentée, le Conseil d’Etat assouplit très largement cette position. En effet, il estime que le tribunal ou la cour peut autoriser « une autre personne intéressée », qui n’est pas partie à l’instance, à prendre la parole au cours de l’audience.
Le Conseil d’Etat ne définit pas ce qu’il faut entendre par « personne intéressée » mais l’espèce qu’il avait à juger lui donne l’occasion de fournir un exemple : une personne qui était partie à la première instance mais n’était plus partie en appel est une personne intéressée qui peut donc être autorisée à prendre la parole à l’audience.
L’on ne peut donc savoir en l’état quelle sera la définition exacte de la « personne intéressée » et donc l’étendue des possibilités offertes aux juges du fond pour entendre une autre personne que les parties. Il s’agit en tout cas d’une évolution importante, le Conseil d’Etat passant d’une vision très stricte à une vision plus ouverte des personnes susceptibles d’être entendues lors de l’audience.
L'Etat est responsable de l'absence de place adaptée pour un enfant handicapé
Le 15/10/2018
Par un arrêt n° 17PA01993 du 10 juillet 2018, la cour administrative d’appel de Paris indemnise une enfant atteinte d’un trouble autistique et sa famille du fait de l’absence de place donnée à celle-ci en institut médico-éducatif (IME) malgré les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) prises en ce sens.
1. En effet, il est désormais jugé de longue date qu’il appartient à l’Etat d’assurer le caractère effectif du droit à l’éducation et de l’obligation scolaire, notamment pour les enfants handicapés. Il a été précisé que les difficultés rencontrées par ces enfants ne sauraient faire obstacle à l’application de ces principes et qu’il appartient à l’Etat de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour assurer de manière effective le droit à l’éducation et l’obligation scolaire.
Ces principes ont été posés par le Conseil d’Etat (CE. SSR. 8 avril 2009, n° 311434, publiée au Recueil) à l’occasion d’une affaire où la cour administrative d’appel de Versailles avait estimé que l’obligation de l’Etat n’était qu’une obligation de moyen et non de résultat. Autrement dit, la cour avait jugé que l’absence de places disponibles pouvait être valablement opposée à l’enfant.
En censurant cette solution, le Conseil d’Etat reprenait en réalité la position adoptée quelques temps plus tôt par la cour administrative d’appel de Paris (CAA de Paris, 11 juillet 2007, Ministre de la santé c. Epoux Haemmerlin, n°s 06PA01579-06PA02793, mentionné aux tables), qui avait jugé que la carence de l’Etat ne pouvait être justifiée par l’insuffisance de moyens budgétaires.
Par la suite, le Conseil d’Etat avait également eu l’occasion de préciser que l’absence de scolarisation d’un enfant, en raison d’une absence de décision d’orientation de cet enfant par la CDAPH, engageait la responsabilité de l’Etat, la position de la CDAPH étant fondé sur l’insuffisance des structures d’accueil et non au manque de diligence des parents.
2. Néanmoins, dans la pratique les cas de condamnations de l’Etat sur ce fondement sont relativement rares.
Dans l’arrêt commenté, la cour administrative d’appel de Paris (qui avait été pionnière dans ce domaine) donne un exemple d’application positive de cette jurisprudence en revenant sur un jugement du tribunal administratif de Paris qui avait rejeté la demande des parents d’une enfant atteinte de troubles autistiques.
Cette enfant avait bénéficié de décisions de la CDAPH l’orientant vers un établissement médico-social. Toutefois, elle n’avait, en pratique, pas bénéficié d’un tel suivi au sein des établissements désignés par la CDAPH et avait été prise en charge par un hôpital de jour de la Croix-Rouge. Néanmoins, cet établissement ne pouvait faire bénéficier l’enfant d’une prise en charge pluridisciplinaire adaptée à ses troubles comme l’aurait fait un institut médico-éducatif (IME) et comme l’exigent les textes.
En première instance, le tribunal avait considéré que la carence de l’Etat n’était pas établie, les parents ne démontrant pas – selon le tribunal – avoir pris contact avec l’ensemble des établissements désignés par les décisions successives de la CDAPH. C’est la raison pour laquelle il avait rejeté leur recours.
En appel, la cour relève que les parents ne démontrent pas avoir saisi, par écrit, l’ensemble des établissements mais constate qu’une grande majorité des établissements contactés par écrit avaient refusé l’enfant du fait de l’absence de places disponibles. Pour les autres établissements, les parents affirmaient avoir fait des démarches par téléphone, ce qui était confirmé par les réponses écrites négatives reçues postérieurement au jugement. La cour ajoute que l’Etat ne démontrait pas qu’une seule place ait été disponible dans les établissements désignés par la CDAPH. Elle en conclut que le fait que les parents ne puissent pas prouver avoir sollicité l’ensemble des établissements par écrit n’est pas de nature à exonérer l’Etat de sa responsabilité, pour sa carence fautive. C’est la raison pour laquelle elle condamne l’Etat.
Cette solution, et l’analyse détaillée des démarches effectuées par les parents de l’enfant à laquelle procède la cour, montrent que l’exigence des juridictions administratives envers les parents est, en pratique, assez élevée.
En effet, la plupart des parents ne songent pas forcément à présenter leurs demandes par écrit (et encore moins en courrier recommandé avec accusé de réception). Or, force est de constater que cela peut leur être reproché par la suite. Même si cela se comprend au vu de l’impératif de preuve devant toute juridiction, il n’en demeure pas moins que la position est sévère.
Au cas présent, les établissements ayant refusé par téléphone de prendre l’enfant faute de places disponibles ayant également confirmé ces refus par écrit (postérieurement au jugement du tribunal mais antérieurement à l’arrêt de la cour), la difficulté a été surmontée.
Cependant, cela démontre la vigilance que les parents doivent apporter à leurs démarches. En effet, ces derniers doivent déjà se préparer à l’hypothèse d’un éventuel contentieux quand ils cherchent une place à leur enfant.
En l’espèce en tout cas, la cour considère que les parents apportent la preuve de leurs démarches et condamne l’Etat.
Cependant, la condamnation paraît symbolique pour une prise en charge inadaptée pendant 7 ans. En effet, l’enfant se voit allouer la somme de 5.000 euros. Or, pour une enfant de cet âge, atteinte de troubles de cette nature, le retard pris dans sa prise en charge peut, potentiellement, ne jamais être rattrapé. Les parents se voient quant à eux allouer, pour leurs démarches et la mise en place d’une prise en charge pendant cette période, une somme de 10.000 euros.
Même si une telle indemnisation paraît limitée dans son montant, le principe de la responsabilité est, lui, reconnu. Ce type de décision, rendu dans le cadre d’un recours indemnitaire, peut en tout cas ouvrir la voie à d’autres types de procédures, plus efficaces, devant le juge administratif.
Le 01/10/2018
Par un avis n° 419204 du 26 juillet 2018, le Conseil d’Etat vient préciser les délais de recours contre une décision créatrice de droit, retirée par l’administration puis rétablie par le juge à la suite de l’annulation du retrait.
En effet, une décision créatrice de droit (c’est-à-dire une décision dont le bénéficiaire peut légitimement considérer qu’elle lui est acquise) peut être retirée par l’autorité qui l’a édictée, en vertu de la jurisprudence Ternon, dans un délai de quatre mois à compter de son édiction si elle est illégale.
Toutefois, il est fréquent que le bénéficiaire de la décision créatrice de droit (une autorisation par exemple) saisisse le juge administratif pour faire annuler ce retrait.
Si le juge fait droit à cette demande d’annulation, la décision de retrait disparaît de l’ordonnancement juridique et la décision créatrice de droit reprend automatiquement vigueur. Se pose alors (comme toujours en droit public) la question du délai de recours contre cette décision créatrice de droit qui (en quelque sorte) revient à la vie : un nouveau délai de recours recommence-t-il à courir ? Si oui, à partir de quand ?
Le Conseil d’Etat avait d’ores et déjà en partie répondu à ces questions (CE. SSR. 6 avril 2007, M. Bernard A. et autres, n° 296493, mentionnée aux tables) en estimant, à propos d’un permis de construire, qu’il reprenait vigueur à compter de la notification du jugement et qu’un nouveau délai de recours commençait à courir à compter des mesures de publication et d’affichage prévues par le code de l’urbanisme.
Dans l’avis commenté, le Conseil d’Etat apporte, cette fois, un mode d’emploi complet à la computation des délais de recours contre une décision créatrice de droit retirée pour remise en vigueur par un jugement d’annulation de la décision de retrait.
▪ En premier lieu, le Conseil d’Etat précise que la décision remise en vigueur ne peut plus être retirée par l’autorité qui l’a émise. Cette précision n’allait pas de soi (principalement si le retrait est annulé pour une question de procédure) mais dans l’intérêt d’une bonne administration il est effectivement préférable que le débat cesse afin d’éviter un jeu de retrait / annulation indéfini.
▪ En deuxième lieu, il rappelle que l’annulation de la décision de retrait rétablit la décision initiale et qu’un nouveau délai de recours contentieux court contre cette décision. Mais il précise, en sus de qu’il avait déjà jugé, que ce nouveau délai commence à courir :
- Dès la notification du jugement si la décision en cause n’a besoin de faire l’objet d’aucune mesure de publicité particulière (une décision individuelle classique).
- A compter des mesures de publicité particulières si elles sont prévues par les textes (comme c’est le cas pour les permis de construire).
▪ En troisième lieu, le Conseil d’Etat précise les modalités d’application de ces principes vis-à-vis d’un tiers particulier pour les collectivités territoriales, à savoir le préfet. En effet, il indique que pour les décisions qui doivent faire l’objet d’une transmission au préfet afin qu’il puisse exercer son contrôle de légalité, cette nouvelle transmission doit avoir lieu dans les 15 jours suivant la notification du jugement (ce délai étant le délai classique prévu par l’article L. 2131-1 du CGCT). Cette notification au préfet fait alors courir le délai dont dispose ce dernier pour éventuellement déférer la décision au tribunal administratif.
Ces précisions, certes relatives à des hypothèses bien particulières, viennent en tout cas clarifier les règles de computation du délai de recours contre les décisions créatrices de droit remises en vigueur par une annulation.